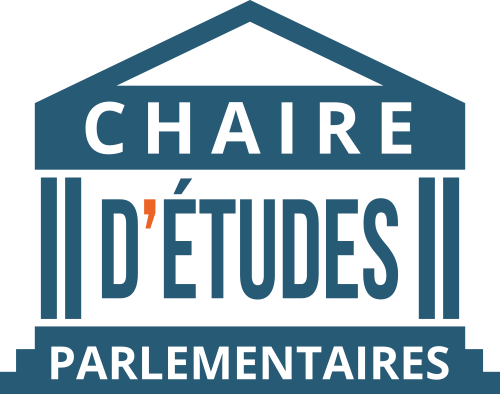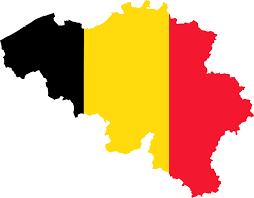Jeudi 13 février 2025, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la tardive loi de finances pour 2025. Au vu de « l’urgence » budgétaire de l’Etat français, la décision attendue depuis la saisine du Conseil du 5 février par 107 députés des groupes du Rassemblement national et de l’Union des Droites pour la République (UDR) et celle du 6 février par 71 députés de la France Insoumise – Nouveau Front Populaire, était hautement prévisible. En revanche, l’enseignement tiré de son contrôle opéré sur le respect du Gouvernement de ses obligations d’information du Parlement est, pour le moins, préoccupant.
L’essentiel du projet de loi de finances pour 2025 a été déclaré conforme à la Constitution, à l’exception de l’article 108, pour non-respect de la règle de l’entonnoir qui impose à une disposition législative, ajoutée en cours de procédure d’adoption d’une loi, de présenter un lien direct avec une disposition restant en discussion – et des articles 155, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 187 et 194, considérés comme des cavaliers budgétaires en ce qu’ils ne rentrent pas dans le cadre du domaine de la loi, tel qu’exhaustivement énoncé à l’article 34 de la Constitution et précisé, en matière financière, par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 (ci-après « LOLF »). À première vue, les conclusions de cette décision semblent être une illustration d’une posture résolument juridictionnelle du Conseil constitutionnel, qui s’attache à réaliser un contrôle de constitutionnalité externe de la loi, objet de sa saisine, en vérifiant qu’elle respecte bien les règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative. Pourtant, à bien y regarder, la présente décision est aussi, et surtout, la démonstration d’une instance qui peine, encore aujourd’hui, à s’émanciper de son rôle initial « d’arme contre la déviation du régime parlementaire ». Si cette posture, préservée dans cette décision, n’est pas vraiment étonnante, elle mérite d’être commentée dans la mesure où elle porte indirectement atteinte au bon exercice d’une fonction traditionnelle – et constitutionnelle – du Parlement : le contrôle du Gouvernement.
Dans la saisine datant du 6 février 2025, les députés, auteurs de la saisine, reprochent au Gouvernement d’avoir enfreint les règles prévues par la LOLF en ce que certains de ses membres auraient refusé de transmettre au président et au rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, des documents budgétaires demandés dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Or, cette demande d’informations formulée par les autorités parlementaires susmentionnées est obligatoire aux termes de l’article 57 de la LOLF, modifié par la loi n°2021-1836 du 28 décembre 2021. D’autant qu’il n’est nulle part précisé, dans le droit, des circonstances (procédure accélérée, état d’urgence, type de documentation, etc.) conditionnant, ou réduisant, l’exercice de ce droit parlementaire qui impose au Gouvernement de se soumettre à des investigations et à transmettre les informations dont il dispose. Le Conseil constitutionnel, lui-même, dans sa décision n°2021-831 DC du 23 décembre 2021, relative à la révision de la LOLF, avait constaté que le renforcement des pouvoirs conférés aux commissions des finances de chaque assemblée pour le contrôle de l’exécution des lois de finances et l’évaluation de toute question relative aux finances publiques « visait à mettre en œuvre, conformément au premier alinéa de l’article 47 de la Constitution, les procédures d’information et de contrôle sur la gestion des finances publiques nécessaires à un vote éclairé du Parlement sur les projets de lois de finance » (paragraphe 92). Plus largement encore, l’exercice de ces prérogatives participe directement à la fonction du Parlement de contrôle du Gouvernement, constitutionnellement reconnue par la révision du 23 juillet 2008 de l’article 24 de la Constitution.
En dépit de la décision susmentionnée, le Conseil constitutionnel rappelle ici que, d’après la jurisprudence constante, « une éventuelle méconnaissance de ces dispositions [organiques] ne saurait faire obstacle à l’examen du projet concerné » (paragraphe 9) et qu’ainsi seule une atteinte dite « substantielle » à ces règles, rangées timidement dans la catégorie des exigences de valeur constitutionnelle de clarté et de sincérité du débat parlementaire, aurait pu entraîner une potentielle déclaration de non-conformité.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel choisit de suivre, implicitement, les observations du Gouvernement reçues le 10 février 2025 et d’interpréter souplement – et sans réelle justification – l’exigence du respect de ces règles précitées, au paragraphe 9 de sa décision : « Si les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que certains documents n’auraient pas été fournis au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l’Assemblée nationale malgré leurs demandes, ils n’établissent pas que, pour très regrettable qu’elle ait été, cette circonstance aurait porté une atteinte substantielle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. » Sous couvert de l’emploi bien peu engageant de la fameuse formule « regrettable », le Conseil constitutionnel considère que le défaut de transmission de documents budgétaires, par le Gouvernement, à des parlementaires détenteurs de pouvoirs particuliers de contrôle en raison de leur fonction respective à la commission des finances, ne constitue pas une atteinte suffisamment « substantielle » aux exigences de valeur constitutionnelle – faisant fi, de facto, de la volonté du législateur organique qui l’avait pourtant explicitement interdit.
Loin d’être isolée, la présente décision s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle du Conseil constitutionnel à la fois peu protectrice des droits de contrôle du Parlement et, surtout, assez laxistes lorsqu’il s’agit de contrôler le respect des obligations gouvernementales vis-à-vis du Parlement. À ne mentionner qu’elles, dans la décision n°2012-654 DC du 9 août 2012, relative à la Loi de finances rectificative pour 2012, le Conseil constitutionnel avait considéré que la procédure d’adoption d’une loi avait été respectée alors que sa discussion – et non son adoption – s’était tenue lors d’une semaine parlementaire lors de laquelle n’avait été organisée aucune séance de questions au Gouvernement, séance pourtant obligatoire aux termes du dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution ; dans la décision n°2017-752 DC du 8 septembre 2017, relative à la Loi pour la confiance dans la vie politique, le Conseil constitutionnel n’avait réalisé qu’un contrôle limité sur la question de l’insuffisance de l’étude d’impact obligatoirement présentée par le Gouvernement au Parlement lors d’un dépôt d’un projet de loi, aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 39 de la Constitution.
Plus largement, cette décision s’ajoute à celles qui illustrent le rôle du Conseil constitutionnel d’« approbateur » des contraintes imposées par le Gouvernement au Parlement. La décision n°2023-849 DC du 14 avril 2023, relative à la Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (Loi sur la réforme des retraites), était, à ce propos, particulièrement démonstrative. Le Conseil constitutionnel avait fait le choix de contredire tous les arguments de détournement de procédure soulevés devant lui alors même que ceux-ci auraient été susceptibles de justifier une atteinte à l’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Or, ce corpus de règles procédurales, adopté progressivement par le constituant et le législateur, ne doit pas être perçu comme des instruments permettant aux groupes d’opposition de ralentir, à dessein, le processus d’adoption d’une loi. Au contraire, à l’heure d’une Ve République qui a permis au Gouvernement d’être largement à la manœuvre dans la procédure législative et qui se retrouve, malgré cela, à subir les conséquences de la situation politique et institutionnelle actuelle, il devrait être envisagé de voir le contrôle parlementaire non comme des punitions à l’encontre du Gouvernement mais comme une solution permettant aux représentants de la nation de s’associer de manière constructive, et en toute connaissance de cause, au débat démocratique.