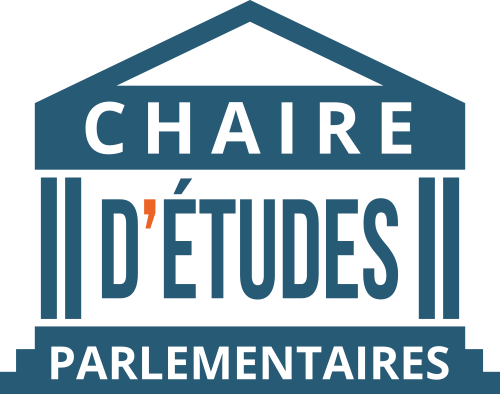Billet à lire en parallèle avec l’analyse de Philippe Blachèr sur la Déontologie : HATVP et Déontologue de l’Assemblée nationale, à propos de deux nominations récentes.
Le mercredi 7 mai dernier, l’Assemblée nationale a prononcé deux sanctions disciplinaires dont la presse s’est largement fait l’écho. Cette réception médiatique est liée tout à la fois à la gravité des sanctions prononcées ainsi qu’au caractère particulier des faits en cause, à savoir un usage malavisé des fonds mis à la disposition des députés pour assurer leur mandat. Ces agissements, révélés par voie de presse puis constatés par le déontologue de l’institution, ont poussé l’Assemblée nationale à réagir vigoureusement. Si le prononcé de sanction à l’Assemblée nationale est devenu un fait banal du fait de la multiplication des sanctions disciplinaires à partir de 2022, les sanctions qui nous intéressent ici ont un aspect nouveau dans la mesure où elles frappent des manquements déontologiques. L’emploi croissant de l’outil disciplinaire a ainsi rejoint le développement, particulièrement marqué depuis dix ans, des règles déontologiques encadrant le mandat des députés. Il y a ici une nouveauté sur laquelle il convient d’insister, sans passer pour autant sous silence les quelques questions que soulèvent ces sanctions.
Une nouveauté : la sanction disciplinaire au soutien du contrôle de la déontologie des députés
Les sanctions prononcées le 7 mai dernier sont la concrétisation d’un cadre juridique mis en place puis continuellement renforcé au cours des dix dernières années. Un code de déontologie a ainsi été intégré au Règlement de l’Assemblée en 2011, précédant une réforme d’ampleur du Règlement de l’Assemblée en 2014 emportant consécration du rôle du Déontologue de l’institution. En 2017, l’ancienne IRFM (indemnité représentative de frais de mandat) est transformée en AFM (avance de frais de mandat, mis à la disposition du député pour la prise en charge des frais liés à l’exercice de son mandat) et placée sous le contrôle du déontologue. Le lien entre cadre déontologique et sanction disciplinaire était établi dès l’origine : l’article 80-4 du Règlement dispose que le Déontologue, confronté à un député qui contesterait avoir manqué à ses obligations ou estimerait ne pas devoir suivre les recommandations qui lui sont faites, peut saisir le bureau afin que ce dernier statue sur le manquement et prononce, le cas échéant, une peine disciplinaire dans le cadre des sanctions disciplinaires prévues par ailleurs par le règlement (c’est à dire les articles 70 à 73 RAN). Ce cadre juridique vaut notamment pour le contrôle de l’usage de l’AFM. L’arrêté du bureau n°12/XV du 29 novembre 2017 relatif aux frais de mandat renvoie ainsi, via son article 3, à la procédure prévue à l’article 80-4 du Règlement.
Jusqu’à présent, les manquements d’ordre déontologique n’avaient pourtant pas donné lieu à sanction disciplinaire. Il est possible d’imaginer que, lors de la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique, l’accent a été davantage mis sur la pédagogie que sur la répression. Il est également possible que les manquements alors constatés n’aient pas atteint un seuil de gravité jugé comme relevant du domaine disciplinaire (1), tandis que d’autres ont vraisemblablement été détectés trop tardivement dans la législature. Il y a donc peu de précédents en la matière, hormis un rappel à l’ordre ayant frappé en 2017 une députée à la suite d’une saisine du déontologue, lequel avait mis en évidence une confusion entre l’exercice du mandat parlementaire et les intérêts de l’entreprise de la parlementaire en question. Le bureau s’en était toutefois tenu à un rappel à l’ordre, mettant en avant que les faits relevaient de la « négligence » (2).
Les temps ont toutefois changé. Il faut dire que les faits mis en avant, largement révélés par voie de presse avant d’être établis par le Déontologue, étaient particulièrement éloquents. Dans un cas de figure, il était question d’usage de l’AFM pour financer les frais de garde d’animaux de compagnie ou encore l’abonnement à des sites de rencontres. Dans l’autre cas de figure, il était question de retraits d’espèces massifs et nocturnes destinés à un usage non professionnel (et suspectés d’avoir eu pour objet l’acquisition de produits stupéfiants). Dans les deux cas de figure, les députés en question ont régularisé leur situation par le remboursement des frais en cause – ce qui, au demeurant, est une obligation légale en vertu de l’arrêté relatif à l’AFM déjà évoqué. Le Déontologue a toutefois estimé que la gravité des faits justifiait de ne pas s’en tenir là. C’est la raison pour laquelle il a, dans le cadre juridique déjà présenté, saisi le bureau de l’Assemblée nationale. À l’appui de cette saisine, le Déontologue a mis en avant la violation par les parlementaires en question de l’article 1 – « les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches » – et de l’article 5 – « les députés veillent que les moyens et indemnités mis à leur disposition soient utilisés conformément à leur destination » – du code de déontologie. Le bureau a rejoint le déontologue en constatant de « graves manquements au code de déontologie » et a proposé à l’Assemblée nationale, à partir des mêmes fondements légaux, la censure avec exclusion temporaire des deux députés en cause, soit la plus lourde sanction prévue par le Règlement (3). L’Assemblée a suivi son bureau en adoptant en séance publique les sanctions proposées. Il faut ici préciser que la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député. Elle entraîne également l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître au Palais Bourbon jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée.
Il faut enfin souligner que le bureau comme l’Assemblée se sont prononcés ici à l’unanimité. Cette union s’explique aisément par la volonté de défendre l’image de l’institution en démontrant que cette dernière réagit fermement face à un détournement particulièrement grossier des frais mis à disposition pour l’usage du mandat. Le Déontologue dans son rapport comme la présidente de l’Assemblée nationale à la tribune ont d’ailleurs employé le même argument : il ne faut pas laisser des comportements isolés jeter l’opprobre sur l’ensemble de la représentation nationale. Si cet impératif n’est pas contestable, il faut toutefois souligner que cet élan répressif soulève tout de même quelques questions.
Quelques questions en suspens
Dans le domaine juridique, la nouveauté comporte souvent une part de bricolage. Ainsi, la sanction disciplinaire pour motif déontologique prononcée en 2017 avait constitué en un rappel à l’ordre apparemment simple. Pourtant, si l’on s’en tient au texte de l’article 72RAN, il ne s’agit pas d’une sanction que le bureau peut prononcer. En ce qui concerne les faits plus préoccupants relevés en 2024, il faut souligner que le Déontologue alertait dans son rapport quant au fait qu’il était démuni pour demander des sanctions contre des députés s’étant caractérisés par un mauvais usage des frais de mandat mais ayant remboursé les sommes dues pour réparer leur faute sur un plan financier (4). Le déontologue proposait, en réaction, d’introduire dans le code de déontologie une référence au principe de dignité qui aurait pour conséquence de faire peser une « exigence d’honorabilité » sur le député. L’idée est d’assurer la possibilité d’une sanction disciplinaire destinée à réparer l’atteinte portée à l’image de la Représentation nationale dans son ensemble, malgré le remboursement des frais de mandat en cause (5). En l’espèce, il faut relever que cette absence n’a pas empêché le Déontologue de saisir le bureau, pas plus que cela n’a empêché le bureau et l’Assemblée de donner suite à cette saisine. Il faut pourtant prendre au sérieux l’avertissement du Déontologue : du point de vue de la lettre de l’article 80-4 RAN, la procédure est peut-être discutable. L’article prévoit en effet une saisine du bureau dans l’hypothèse où le député « conteste avoir manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue ». Or, cela ne semble pas être stricto sensu le cas en l’espèce puisque, comme le souligne le déontologue lui-même, les députés en question ont remboursé l’essentiel des dépenses qui leur étaient reprochées, et cela justement pour s’exonérer de toute faute. Cela n’a pas empêché l’Assemblée nationale de retenir contre eux la sanction la plus lourde possible. Si les motifs animant ici l’Assemblée sont évidents, l’orthodoxie de cette mise en œuvre à l’égard de la lettre des dispositions règlementaires est sans doute plus discutable. Dans ce contexte, les recommandations présentées dans le dernier rapport de l’ancien Déontologue prennent tout leur sens.
Le caractère adapté des sanctions est une autre question délicate. Le bureau a proposé, dans un souci de sévérité, la sanction la plus lourde possible. Son caractère adapté peut toutefois se discuter. Elle aboutit concrètement à écarter des travaux parlementaires deux députés déjà largement disqualifiés. L’un d’entre eux s’est volontairement mis en retrait de l’Assemblée et n’exerce de fait plus son mandat. L’autre, expulsée par son propre groupe politique, s’entête à y jouer un rôle qui ne pourra dépasser un rôle de figuration. Au-delà du symbole et de la sanction financière accessoire à la censure avec exclusion temporaire, la sanction semble ainsi passer à côté de son objet. La présidente de l’Assemblée nationale l’a d’ailleurs reconnu en évoquant la possibilité d’une réflexion nouvelle sur l’échelle des sanctions disciplinaires. Il n’y a pas à aller chercher bien loin pour établir le caractère inadapté à la matière déontologique des sanctions existantes : ces dernières ont été pensées pour ramener l’ordre en séance publique. Elles sont centrées sur le rappel à l’ordre, la censure ou l’éloignement temporaire de l’élément perturbateur, dans la perspective d’un retour au calme. Elles ne sont donc pas adaptées à la sanction d’un manquement déontologique, pour la simple raison qu’elles n’ont pas été pensées pour cela. Là encore, il y a de la place pour une réflexion approfondie sur la place des sanctions disciplinaires dans la répression des manquements déontologiques. Si le présent texte n’est pas le lieu pour développer ce point, les pistes n’en sont pas moins déjà connues : il est possible d’évoquer, à titre d’exemple, la procédure de recall mise en œuvre au Royaume-Uni et destinée à provoquer une élection partielle remettant en jeu le siège d’un élu qui aurait été sanctionné pour des manquements déontologiques graves (6). Les faits ici rapidement commentés, lesquels révèlent le caractère peu adapté du cadre disciplinaire actuel, pourraient relancer les propositions de ce type. Même sans aller jusque-là, il apparaît – a minima – qu’une réflexion sur l’adaptation du cadre disciplinaire existant est nécessaire.
(1) A. ROBLOT-TROIZIER, Le temps de l’appropriation des réformes déontologiques à l’Assemblée nationale, rapport annuel de la déontologue pour l’année 2020, p. 18.
(2) Compte-rendu du bureau de l’Assemblée nationale, réunion du mercredi 27 septembre 2017, [https://www2.assemblee-nationale.fr/15/le-bureau-de-l-assemblee-nationale/comptes-rendus-et-convocation/2017/reunion-du-mercredi-27-septembre-2017].
(3) Compte-rendu du bureau de l’Assemblée nationale, réunion du mercredi 7 mai 2025, [https://www2.assemblee-nationale.fr/17/le-bureau-de-l-assemblee-nationale/comptes-rendus-et-convocation/2025/reunion-du-mercredi-7-mai-2025].
(4) J-É. GICQUEL, La déontologie parlementaire à l’épreuve de la dissolution, Rapport annuel de la déontologue pour l’année 2024, p. 44 et s.
(5) Ibid., p. 46.
(6) V. B. JAVARY, « Premier succès pour le recall à la Chambre des Communes britannique : un exemple pour la France ? », Jus politicum blog, 20 mai 2019, [https://blog.juspoliticum.com/2019/05/20/premier-succes-pour-le-recall-a-la-chambre-des-communes-britannique-un-exemple-pour-la-france%E2%80%89-par-baptiste-javary/] ; Pour une proposition de dupliquer pour les parlementaires le mécanisme de l’article 68 de la Constitution existant pour le président de la République, v. D. BARANGER, « La Constitution et le statut des députés : que faut-il changer ? », Jus politicum blog, 20 octobre 2017, [https://blog.juspoliticum.com/2017/10/20/la-constitution-et-le-statut-des-deputes-que-faut-il-changer/].