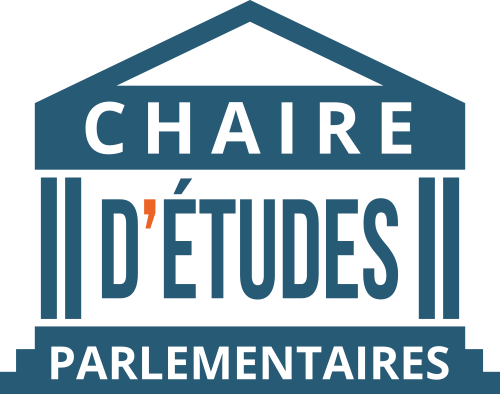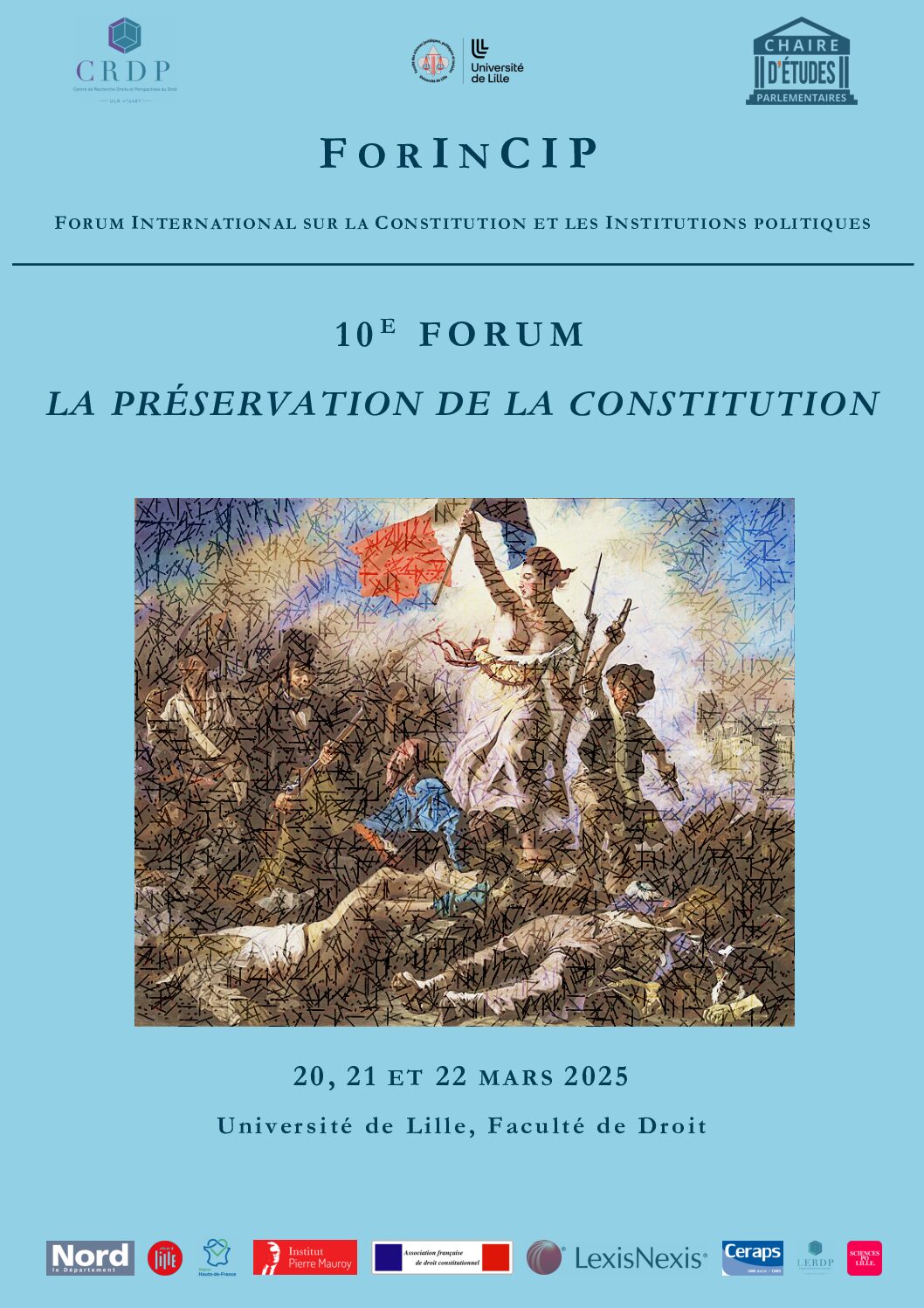Les textes budgétaires sont au cœur de la vie politique. Sans loi de finances ni loi de financement de la sécurité sociale, c’est l’ensemble de l’action publique qui se grippe. La Constitution en a tiré les conséquences en encadrant strictement leur examen. Passé un certain délai, le Gouvernement peut mettre le budget en vigueur par ordonnances, sans vote définitif du Parlement. Parlementaires et Gouvernement se rejoignent sur la nécessité de doter la France d’un budget. Pourtant, à l’automne 2025, les députés ont précisément laissé filer les délais sur le PLFSS 2026. Après vingt jours de débats en première lecture, le délai constitutionnel a expiré. Ni l’examen complet du texte, ni son vote global, n’a pu advenir. Largement amendé, il a été transmis au Sénat à minuit, le 13 novembre 2025, faute de temps. Cette séquence offre un poste d’observation privilégié, que l’analyse prolonge sur le PLF 2026, où les dilemmes se cristallisent différemment.
Le paradoxe est là. Si le temps presse, pourquoi les débats s’étirent-ils, pourquoi les amendements se comptent-ils par milliers, pourquoi certains députés s’abstiennent ou se retirent de l’hémicycle au moment du vote ? En l’absence de majorité absolue, assiste-t-on à un simple chaos parlementaire ou à un ensemble de stratégies plus structurées, combinant contraintes institutionnelles, électorales et partisanes ?
L’ambition de ce texte est moins de retracer pas à pas la séquence budgétaire que de proposer un bilan théorique des logiques stratégiques qu’ouvre cet encadrement procédural en situation de majorité relative. Pour des raisons de concision, l’analyse se concentrera sur trois groupes d’opposition (LFI, PS et RN) ainsi que sur la Droite Républicaine, ces cas fournissant des points d’appui particulièrement pertinents à la démonstration. S’il serait inexact de classer les députés de la Droite Républicaine parmi les groupes d’opposition au sens strict, les désaccords qui les opposent au reste de la coalition gouvernementale sont suffisamment marqués pour qu’il soit heuristique, pour notre démonstration, de les y assimiler.
Pour le comprendre, nous raisonnerons en termes d’acteurs en distinguant trois pôles, chacun confronté à un dilemme propre. D’abord les groupes d’opposition retenus, partagés entre une stratégie de rupture et une stratégie de compromis, qui structurent la négociation des amendements, le tempo des débats et la mobilisation des députés. Ensuite le Gouvernement et sa coalition, contraints d’arbitrer entre la maîtrise du contenu et la survie gouvernementale, en combinant compromis budgétaires et instruments procéduraux (49, al. 3, ordonnances). Enfin l’Élysée, où la séquence budgétaire se déplace vers des décisions de personnel et de calendrier, de la (re)nomination du Premier ministre à l’éventuelle dissolution, voire à la mise en jeu de la continuité du mandat présidentiel.
Les textes budgétaires obéissent à des délais spécifiques. Pour le projet de loi de finances (PLF), l’article 47 de la Constitution fixe à 70 jours, à partir du dépôt définitif du projet, le délai dont dispose le Parlement pour se prononcer. Ce délai est fixé par l’article 47-1 à 50 jours pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Deux conditions cumulatives, mais suffisantes, doivent être réunies pour que les dispositions de ces textes budgétaires puissent être mises en vigueur par ordonnances (art. 47 al. 3 et 47-1 al. 3) :
– une condition temporelle : l’échéance du délai de 70 jours (PLF) ou 50 jours (PLFSS) ;
– une condition matérielle : que le Parlement, c’est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat, ne se soit pas « prononcé », autrement dit qu’il n’ait ni adopté définitivement ni rejeté définitivement le texte.
Si ces deux conditions sont réunies, le Gouvernement peut, s’il le souhaite, recourir aux ordonnances. Ainsi, l’Assemblée nationale, à elle seule, ne peut pas empêcher le recours aux ordonnances, sauf si le Gouvernement lui demande de statuer définitivement (article 45, al. 4). Son seul levier propre consiste à censurer le Gouvernement en amont, gageant qu’un nouveau Gouvernement n’y aura pas recours, sauf à s’exposer à une nouvelle censure.
I) Le dilemme des oppositions : rupture ou compromis ?
Du point de vue des oppositions, voter contre un budget paraît à première vue logique. Pourtant, ce rejet a des effets juridiques très limités. Un vote négatif à l’Assemblée ne bloque ni la poursuite de la navette ni, a fortiori, l’entrée en vigueur du budget, puisque le Gouvernement est le seul à pouvoir décider de saisir l’Assemblée pour qu’elle ait le « dernier mot » et peut si besoin recourir aux ordonnances. Dans cette perspective, le rejet du budget relève a priori d’une dimension essentiellement symbolique.
Cela peut expliquer pourquoi une partie de l’opposition s’investit fortement dans le dépôt d’amendements. Si le dépôt massif ralentit les débats et, in fine, réduit la possibilité d’un vote sur le texte, l’absence de majorité absolue crée une opportunité inédite pour les oppositions de faire adopter leurs amendements. Il suffit d’un sujet trop peu engageant pour certains, suffisamment mobilisateur pour d’autres, et un amendement peut être adopté presque par le hasard des motivations et des présences qu’elles impliquent. Les récentes séquences budgétaires ont ainsi vu l’adoption d’amendements d’opposition, parfois très symboliques. Pour les oppositions, déposer de très nombreux amendements, quitte à allonger les débats, peut donc être une stratégie rationnelle. Certains ayant une véritable chance d’être adoptés, ils peuvent ensuite être revendiqués comme des victoires symboliques et politiques, même dans le cadre d’un budget globalement combattu et dont l’adoption est considérée comme peu probable.
Cela peut également expliquer l’absentéisme de certains députés en séance. Celle-ci est cependant fonction de deux autres facteurs au moins. Il existe à l’Assemblée ce qu’on peut appeler un « gentleman agreement » de la mobilisation. Lorsque l’issue d’un vote est largement prévisible (adoption ou rejet quasi certain), les groupes ajustent souvent leur mobilisation afin de ne pas « gaspiller » une présence massive sur un scrutin joué d’avance. À l’inverse, lorsque le résultat est incertain, la mobilisation devient un enjeu en soi et chaque camp tente de faire venir un maximum de députés en séance pour remporter le vote. C’est l’une des raisons pouvant expliquer la mobilisation partielle des oppositions sur la partie dépense du PLFSS 2026. S’y ajoute la concurrence entre arènes. Les députés jonglent entre commission et séance plénière, présence en circonscription et autres impératifs de représentation. Même si les séances simultanées entre commission et plénière font généralement l’objet d’une suspension de quelques minutes pour permettre aux commissaires de participer aux votes importants dans l’hémicycle, il n’en reste pas moins qu’ils doivent arbitrer entre les différents bénéfices attendus de ces différentes arènes.
Enfin, et plus fondamentalement, cela peut expliquer les différentes stratégies adoptées par les groupes d’opposition, confrontés à un dilemme récurrent, particulièrement aigu d’une part chez LFI et le RN et d’autre part chez les Socialistes et la Droite Républicaine.
Les premiers optent pour une stratégie de rupture et, refusant de « choisir entre la peste et le choléra », poussent au rejet d’un budget perçu comme nécessairement injuste ou mal orienté. Hadrien Clouet, député LFI, expliquait ainsi durant l’examen du PLFSS 2026 « « on va vous couper deux doigts », moi je suis pas d’accord avec ça, un socialiste sort de dessous la table en disant, « on va vous en couper qu’un », je suis pas d’accord non plus ». Jean-Philippe Tanguy, député RN, affirme quant à lui durant le PLF 2026 « Les députés LR ont trahi leurs électeurs ».
Les seconds optent pour une stratégie de compromis consistant à assumer le choix du « moins pire » pour éviter le vide budgétaire ou un texte encore plus défavorable. À propos du PLF 2026, le député socialiste Jérôme Guedj déclarait : « pas à pas on essaie d’obtenir des avancées […] et nous on joue le jeu en responsabilité ». Sur le même texte, le président du groupe Droite Républicaine, Laurent Wauquiez, affirmait quant à lui que « pour l’instant on est en train de se battre pour le corriger […] on fait pas tomber un Gouvernement à la légère ».
Par conséquent, voter contre le budget permet de présenter une forme de cohérence avec la posture d’opposition. Il s’agit de comparer son propre programme budgétaire avec le texte soumis au vote. À l’inverse, s’abstenir ou même voter en faveur d’un budget amendé peut être présenté comme un acte responsable, « nous avons évité le pire ». L’évaluation consiste alors à comparer le texte initial, porté par l’adversaire, et la version examinée. Le vote des amendements peut obéir à la même logique. Chaque vote peut être interprété comme un refus de participer au moindre compromis ou, au contraire, comme un signe de « gouvernementabilité ». Le vote sur l’article 45 bis du PLFSS, qui suspend jusqu’à la présidentielle le relèvement de l’âge légal vers 64 ans, reflète ainsi des postures évolutives selon les groupes.
Il convient à présent de rappeler que le vote pour ou contre un budget n’obéit pas uniquement à une logique d’évaluation du texte budgétaire lui-même. L’arbitrage peut également intégrer un calcul relatif aux conséquences procédurales au-delà du texte lui-même. L’opposition va donc évaluer les gains potentiels et les risques d’un 49, al. 3 et des ordonnances. Du côté des oppositions de rupture, voter contre peut permettre d’aboutir à l’une de ces deux procédures puis à la motion de censure, elle-même pouvant être un levier susceptible d’ouvrir une recomposition politique (changement de Gouvernement, dissolution, démission du Président). Marine Le Pen, interrogée sur une éventuelle motion de censure dans le contexte du budget 2026, résume cette stratégie en jugeant que l’exécutif ne doit pas « s’accrocher à son siège [mais] accepter que des élections aient lieu ». Mathilde Panot formule un cadrage analogue en affirmant que « la seule solution reste le retour aux urnes ». Dans cette perspective, il s’agit alors de préparer une motion de censure au moment le plus symboliquement coûteux pour l’exécutif, par exemple après un 49, al. 3, à la veille ou au lendemain d’ordonnances. Du côté des oppositions de compromis, le 49, al. 3 peut être l’occasion de faire passer un budget négocié avec le Gouvernement. Laurent Wauquiez valide ainsi implicitement l’usage du 49, al. 3 estimant qu’« il ne serait pas sérieux de faire tomber le Gouvernement et de laisser la France sans budget », tandis qu’Olivier Faure souligne clairement qu’ « on ne peut jamais se contenter de l’utilisation du 49.3, mais il n’y avait pas non plus beaucoup d’alternatives ». Ces propos peuvent s’expliquer soit par la volonté de ne pas assumer le coût symbolique d’un vote explicite dans l’hémicycle, soit afin de limiter les coûts d’un allongement des débats budgétaires.
La durée des débats fait d’ailleurs partie intégrante du calcul. Pour amener le Gouvernement à recourir au 49, al. 3 ou aux ordonnances et, plus largement, pour peser sur l’issue des négociations, l’opposition peut chercher soit à créer l’urgence, soit à gagner du temps, en provoquant l’adoption d’une loi spéciale, laquelle assure un budget provisoire sur la base de l’exercice précédent. Dans ce cadre, le texte budgétaire en discussion est apprécié non seulement au regard de l’hypothèse d’une loi spéciale, mais également au regard des coûts politiques et économiques qui y sont associés, tenant aux incertitudes d’exécution, aux risques de gel ou de retard lorsque les mesures d’application tardent ou sont limitées, ainsi qu’aux tensions susceptibles d’apparaître avec les collectivités et les acteurs dépendant des crédits.
À cet égard, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, ayant chiffré le coût financier qu’implique la loi spéciale, affirmait que « l’an dernier, on avait estimé à 12 milliards le coût d’avoir six à huit semaines sans budget ». Par ailleurs, le décret dit « des services votés » implique le « blocage » de certaines dépenses, celles-ci étant strictement limitées à celles jugées « indispensables à la continuité des services publics ». Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, en conteste toutefois le champ d’application en estimant qu’« il ne vous appartient pas [le Gouvernement] de déguiser vos décisions discrétionnaires en fatalités techniques ».
Pour se démêler de cet entrelacs de comparaisons stratégiques, les oppositions doivent interpréter les attentes et préférences de leurs électeurs, et arbitrer en fonction de la balance bénéfice-risque, et ce d’autant plus à l’approche d’élections municipales (mars 2026) et de potentielles législatives anticipées à la suite de l’élection présidentielle de 2027. Il ne s’agit pas seulement ou nécessairement d’un calcul pour préserver son siège, mais d’une évaluation plus large, celle du respect de la volonté des électeurs et des chances de victoire ou d’échec de son bloc politique aux prochaines élections. C’est du moins la logique que l’on peut comprendre du discours d’Olivier Faure, « on aurait dissous, est-ce que vous pensez sérieusement que la France Insoumise serait majoritaire à elle seule au Parlement et qu’elle pourrait imposer l’abrogation de la réforme des retraites [..] s’il y avait demain une démission du chef de l’État est-ce qu’on est sûr que Jean-Luc Mélenchon serait élu ? ». En somme, les oppositions peuvent adopter deux stratégies différentes, celle de la sûreté de gains modestes mais présents ou celle du risque de gains ambitieux mais futurs.
II) Le dilemme du Gouvernement et de sa coalition : « le bon ou le mauvais budget » ?
Sans majorité absolue à l’Assemblée nationale, le risque est grand pour la coalition gouvernementale d’y voir les textes budgétaires être rejetés, contrairement au Sénat où Les Républicains et l’Union centriste forment une majorité absolue. Pour autant, l’enjeu pour le Gouvernement n’est plus seulement de faire passer un budget, mais de survivre à la séquence budgétaire. Une majorité simple suffit pour faire adopter le texte, mais seule une coalition capable de réunir 289 voix peut garantir à la fois l’adoption des lois de finances et le maintien du Gouvernement face aux motions de censure. Tout l’art consiste alors à obtenir un accord explicite ou implicite de non-censure de la part d’une partie des oppositions, sans pour autant les transformer en simples béquilles de la majorité.
Concrètement, la coalition gouvernementale oscille entre trois options, dont aucune ne permet d’atteindre simultanément la maîtrise du contenu, le maintien du Gouvernement et la pacification symbolique de la séquence. La première option est celle d’un budget amendé, adopté de justesse après de multiples concessions parlementaires. Elle réduit le risque immédiat de censure, mais elle a un coût politique clair, puisqu’elle renvoie aux électeurs l’image d’une coalition structurellement fragilisée et d’une dépendance accrue à l’égard de partenaires idéologiquement éloignés. C’est la séquence du PLFSS 2026. La seconde option est celle d’un budget amendé, adopté par 49, al. 3 à la suite de négociations. Elle réduit également le risque immédiat de censure, mais engendre là encore un coût d’image politique. C’est la séquence du PLF 2026. La troisième option est celle d’un budget initial, mis en œuvre par ordonnances, permettant « le bon budget », mais que nombre d’oppositions dénonceraient comme un coup de force et qui ferait peser la menace très sérieuse d’une censure. Ce scénario n’a encore jamais eu lieu sous la Ve République.
En cas de doute, la coalition gouvernementale peut se donner le temps de réfléchir en laissant les débats s’enliser. Il peut s’avérer rationnel de multiplier les amendements et les prises de parole, d’accepter, voire d’encourager, une forme d’obstruction sur ses propres textes. En repoussant les votes décisifs le plus tard possible, l’exécutif limite le risque d’un rejet humiliant à l’Assemblée (première lecture du PLFSS 2026) tout en espérant une issue plus contrôlée, au Sénat, puis en commission mixte paritaire (CMP). En effet, plus les débats s’étirent, plus il devient possible de laisser expirer les délais sans vote global. Si, au terme des 20 jours (PLFSS) ou des 40 jours (PLF) de première lecture, l’Assemblée ne s’est pas prononcée, le Gouvernement transmet au Sénat le projet de loi dans sa version initiale, ou, si le Gouvernement le souhaite, modifié par les amendements votés à l’Assemblée et choisis par lui (art. 40 al. 3 LOLF). Si le Parlement ne parvient pas à un accord, ce qui fut le cas sur le PLF 2026, il peut alors opter pour un 49, al. 3 négocié ou prendre le risque, si le Parlement ne s’est toujours pas prononcé au bout de 50 ou 70 jours, de clore la séquence par ordonnance.
Dans le cas du PLF 2026, le Gouvernement a finalement opté pour le 49, al. 3, alors même que le Premier ministre s’était engagé à ne pas en faire usage. Pourquoi un tel revirement ? D’abord parce que, selon l’interprétation du SGG, l’ordonnance budgétaire ne permet pas de mettre en vigueur un budget négocié, seul le texte initial peut être mis en œuvre. À défaut, l’exécutif pourrait être tenté de laisser filer systématiquement les délais pour gouverner par ordonnances, ce qui viderait l’encadrement constitutionnel de sa portée. Ensuite, parce que cette lecture rend politiquement très risquée la sortie par ordonnances. La mise en vigueur de la copie initiale du budget exposerait le Gouvernement à une censure presque immédiate, tant l’opposition pourrait y voir un contournement du Parlement. Le 49, al. 3 apparaît alors comme l’option la moins instable. Il permet de faire adopter un texte amendé, donc présentable comme le produit d’une négociation, et de réduire le coût politique pour les groupes susceptibles de choisir la non-censure. On notera toutefois qu’un autre scénario restait possible, mais relevait davantage d’un arbitrage élyséen.
III) Le dilemme élyséen : quand le budget devient affaire de têtes
Enfin, au-delà des murs de l’Assemblée et des arbitrages interministériels, un troisième acteur structure le jeu : l’Élysée. Cette institution peut décider, en dernière instance, de la (re)nomination du Premier ministre, de la possibilité d’une dissolution ou de la démission du chef de l’État.
L’une des prérogatives de l’Élysée est celle de la (re)nomination du Premier ministre. Elle introduit dans la séquence budgétaire une propriété stratégique simple. La menace parlementaire qu’est la censure n’emporte pas mécaniquement inflexion de la ligne budgétaire, dès lors que la démission du chef du Gouvernement peut être immédiatement suivie d’une reconduction. Du côté de Matignon, l’alternative demeure, nous l’avons vu, de faire adopter un budget négocié au prix de concessions parfois significatives, ou d’assumer par ordonnances un « bon » budget au regard du projet présidentiel, mais en prenant le risque d’une censure. Or, du point de vue de l’Élysée, cette seconde option pouvait être envisagée sans mettre durablement en péril le poste du Premier ministre. En acceptant de jouer, au besoin, le rôle de fusible temporaire, ce dernier pouvait ainsi voir dans les ordonnances budgétaires un moyen de maintenir, sans concession, la politique budgétaire présidentielle.
Pourquoi cette stratégie ne fut-t-elle pas adoptée ? Une telle pratique ne manquerait pas de susciter de vives contestations. L’opposition serait très probablement incitée à redéposer, dès que possible, une nouvelle motion de censure afin de faire valoir la position exprimée par la représentation nationale. Pour autant, pourrait s’ensuivre une succession de censures et de nominations qui finirait rapidement par jouer en faveur de l’Élysée et de son Premier ministre. En effet, « un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire » (art. 49 al. 2 C). La motion de censure « spontanée » constitue donc une ressource juridiquement limitée. En supposant que chaque dépôt ne réunisse que le seuil minimal de 58 signataires, une opposition de 456 députés ne peut déposer que 18 motions au cours d’une même session ordinaire. Ce plafond tombe à 9 si l’on ne retient que les oppositions de rupture (LFI et RN). Dès lors, pourquoi cette stratégie n’a pas été retenue ? On peut l’expliquer par l’existence de coûts d’une autre nature : risque de contentieux constitutionnel, répercussions électorales sur le camp présidentiel, coût symbolique et réputationnel, et plus largement exposition à l’accusation de détourner l’esprit de la Constitution.
Le pouvoir de dissolution constitue une autre prérogative présidentielle, à la fois particulièrement puissant et politiquement risqué. L’histoire de la Ve République montre que son usage ne produit pas mécaniquement une « clarification » et qu’il peut au contraire affaiblir le camp présidentiel. On retiendra bien sûr la dissolution décidée par Jacques Chirac. Élu en 1995, le Président dispose alors d’une majorité parlementaire pléthorique, issue des législatives de 1993, avec 483 députés. Mais le décalage des calendriers (le mandat présidentiel étant de sept ans et celui des députés de cinq), implique que cette majorité remette son mandat en jeu dès 1998. Anticipant une rentrée politique difficile, Jacques Chirac dissout l’Assemblée au début du mois de juin 1997. Le Président subit alors une défaite cinglante et sa majorité perd 221 sièges. La gauche obtenant la majorité absolue, le Président est contraint d’entrer en cohabitation et nomme Lionel Jospin Premier ministre. L’histoire récente rappelle ensuite la dissolution de 2024, décidée par l’Élysée après l’échec du camp présidentiel aux élections européennes. Elle s’est traduite par un recul net de la majorité présidentielle, déjà relative, passant de 246 sièges en 2022 à 168 en 2024. Enfin, une note récente du CEVIPOF fondée sur l’enquête Fractures françaises (Ipsos) indiquait que l’hypothèse d’une nouvelle dissolution s’inscrirait dans un contexte défavorable au camp présidentiel.
Recourir à la dissolution semblait donc une arme trop dangereuse pour l’Élysée. Pour autant, il peut être opportun, à minima, de s’en servir comme un levier dissuasif afin de peser sur les négociations budgétaires avec l’opposition. Selon Le Parisien, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, aurait recouru à ce levier en demandant à son ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, de « préparer les modalités d’éventuelles élections législatives ». Cette démarche n’a probablement pas été engagée sans l’avis du Président de la République.
Un dernier levier est entre les mains de l’Élysée, la démission du Président lui-même. Quelle que soit l’évaluation que l’on retienne de la crédibilité de cette hypothèse, celle-ci a connu une évolution sensible au fil de la séquence. Lors de l’examen des textes budgétaires entre octobre 2024 et février 2025, se posait une contrainte de calendrier institutionnel. En effet, si une démission était intervenue moins d’un an après les élections législatives de juillet 2024, le Président nouvellement élu aurait hérité de l’Assemblée en place sans pouvoir la dissoudre, l’article 12 de la Constitution interdisant toute dissolution dans l’année qui suit un scrutin législatif consécutif à une première dissolution. Par ailleurs, le nouveau Président aurait été confronté, quelques mois après son élection, à de nouvelles élections législatives, remettant indirectement son propre mandat en jeu dans un contexte de majorité relative. Ensuite, même à partir de juillet 2025, l’hypothèse pouvait relever d’une logique performative de la part de l’opposition, sa mise en circulation dans l’espace public constituant une tentative d’en accroître la crédibilité. Néanmoins, la défection de certains soutiens de premier plan du Président a relayé l’hypothèse au-delà des seuls rangs de l’opposition. Le 6 octobre 2025, Gabriel Attal affirmait sur le plateau de TF1, « je ne comprends plus les décisions du président de la République ». Le lendemain, Édouard Philippe allait plus loin : « il me semble qu’il s’honorerait [le Président] s’il nommait un Premier ministre avec pour fonction de faire adopter un budget. Dès lors que la France est dotée d’un budget, et c’est indispensable, il annonce qu’il organise une élection présidentielle anticipée ».
Le budget 2026 ayant été adopté, force est de constater que cette hypothèse n’a pas trouvé de traduction institutionnelle. Le Président aurait-il pu juger sa démission nécessaire si celle-ci avait été relayée par nombre de figures politiques, médiatiques ou économiques majeures ? Mais surtout, quel aurait pu être, au-delà d’une réponse aux pressions, l’intérêt d’une telle démission ? Il n’aurait pas pu résider dans la possibilité de briguer un troisième mandat, l’interprétation juridique étant à cet égard parfaitement claire. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inscrit à l’article 6 de la Constitution l’interdiction d’exercer « plus de deux mandats consécutifs ». Un mandat, même écourté par une démission, compte intégralement, rendant inconstitutionnelle toute candidature immédiate après deux exercices. L’intérêt d’une telle démission ne pourrait donc être que de nature symbolique ou tactique.
Pour en mesurer la portée, on pense à l’unique précédent de la Ve République, la démission du général de Gaulle, le 28 avril 1969, au lendemain de l’échec du référendum du 27 avril qu’il avait explicitement transformé en vote de confiance. Mais la comparaison est étroite. L’acte gaullien s’inscrivait dans une logique plébiscitaire et de légitimité personnelle, difficilement transposable à une crise parlementaire et budgétaire. La référence à 1969 pourrait offrir une ressource symbolique, mais elle demeurerait politiquement ambivalente, car une démission serait aujourd’hui susceptible d’être interprétée moins comme un geste d’autorité que comme l’aveu d’une incapacité à gouverner. À mesure que l’échéance présidentielle approche, la démission présidentielle apparaît peu vraisemblable, à moins qu’une crise d’ampleur exceptionnelle ne vienne bouleverser la séquence politique.
***
L’examen des textes budgétaires en l’absence de majorité absolue donne, vu des tribunes ou des réseaux sociaux, une impression de désordre : amendements en masse et imprévisibilité de leur sort, débats nocturnes, députés absents, examen interrompu ou rejet en première lecture, réexamen au Sénat, puis adoption par 49, al. 3. Mais derrière ce brouhaha, les comportements des acteurs sont largement contraints par le jeu institutionnel et partisan.
Du côté des oppositions, les marges de manœuvre apparaissent a priori largement symboliques, l’Assemblée ne pouvant ni mettre fin à l’examen parlementaire du texte, ni empêcher l’entrée en vigueur du budget. Elle ne peut que retarder, amender ou accepter le budget. Dans cette configuration, les uns peuvent miser sur une recomposition politique, les autres sur un budget négocié. Du côté du gouvernement et de sa coalition, il lui faut faire le choix entre un budget négocié contre sa volonté, via le débat parlementaire et/ou le 49, al. 3, ou risquer les ordonnances. Du côté de l’Élysée, la séquence budgétaire est le moment où le Président décide s’il maintient ou remplace son Premier ministre, s’il provoque une dissolution, voire démissionne.
C’est dans cet entrelacs de contraintes juridiques, électorales et partisanes que se joue le « jeu à trois bandes » des finances publiques en temps de majorité relative. Dans ce jeu en miroir, les groupes partisans ne manquent pas de s’accuser mutuellement d’arrière-pensées inavouables, d’incohérence, voire de trahison. Bien malheureuse est alors la représentation nationale qui, devant arbitrer entre pragmatisme et idéalisme, entre stratégie et image publique, se voit plus incomprise et plus chaotique que jamais.