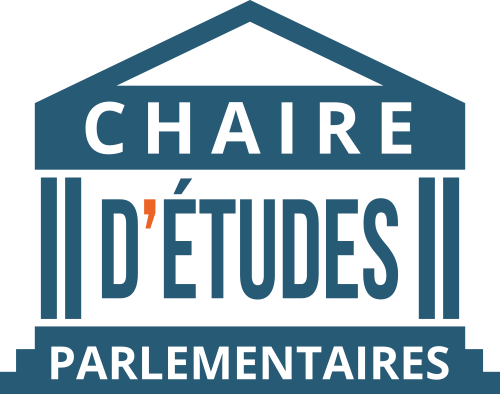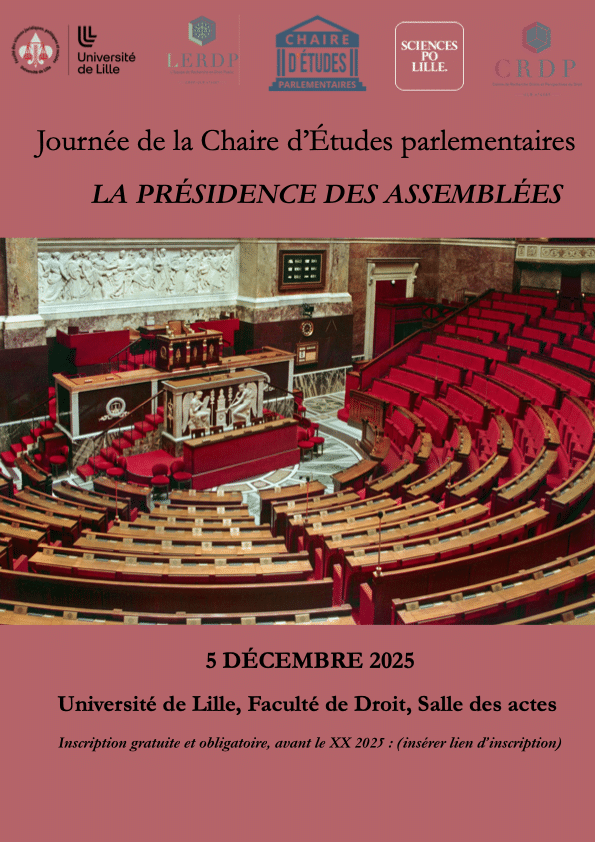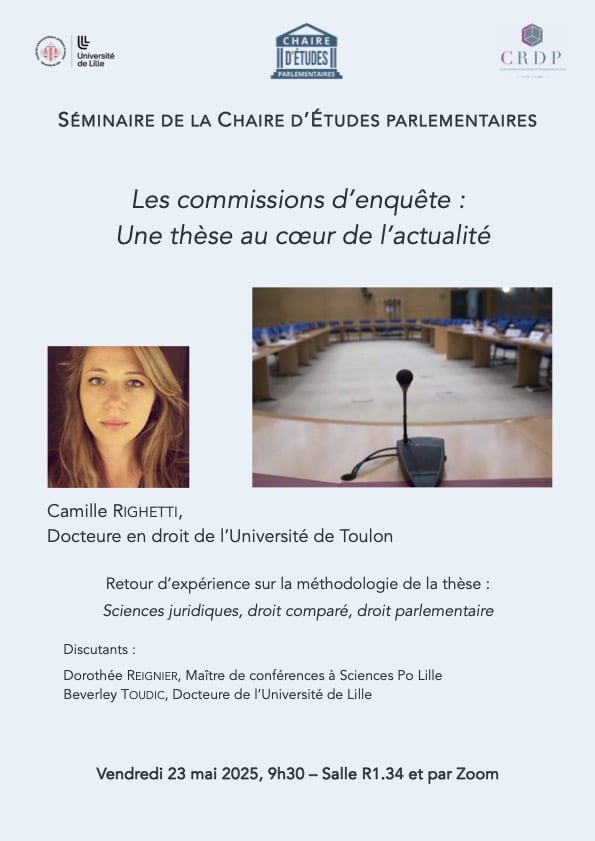Le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné 24 personnes, dont Marine Le Pen, présidente du Front national au moment des faits, d’un délit de détournement de fonds publics. Plus précisément, Marine Le Pen a été condamnée à une peine de 4 ans de prison, dont deux ferme (aménagés sous bracelet électronique), 100 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire (1).
La peine d’inéligibilité est une peine complémentaire, dont les modalités d’exécution (l’exécution provisoire) ont pour conséquence d’empêcher Marine Le Pen de se présenter à l’élection présidentielle de 2027, bien qu’elle conserve son mandat de députée du Pas-de-Calais. Selon les juges, Madame Le Pen pourrait faire l’objet d’une condamnation définitive ce qui pourrait engendrer des conséquences majeures.
Au cours de précédents procès (Balkany, Fillon, Sarkozy ou encore l’affaire Falco), des tensions entre justice et politique étaient déjà apparues après que fut proclamée une condamnation pour inéligibilité privant, selon certains, l’électeur de son libre arbitre. Néanmoins, le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 31 mars dernier a fait l’objet de vives critiques, alors que l’institution judiciaire y sanctionne un détournement de fonds de plusieurs millions d’euros.
A l’issue de ce débat, il conviendra de s’assurer que l’exigence de neutralité du juge a été respectée sans porter atteinte au principe démocratique de la liberté des électeurs.
Selon Dominique Lottin (membre du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) et ancienne membre du Conseil constitutionnel), si les tensions sont de plus en plus fortes entre justice et politique, cela s’explique, entre autres, par le choix du législateur dans une logique de moralisation de la vie publique et de restauration de la confiance des citoyens, de confier au juge le soin de sanctionner les élus auteurs de détournements de fonds publics ou de financements illicites, et de lui permettre de prononcer à leur encontre une peine d’inéligibilité. On assiste donc à une politisation du débat judiciaire bien que, dans l’enceinte de leur palais de justice, les juges s’en tiennent éloignés. Contextuellement, les attaques contre les juges s’inscrivent dans un mouvement général de déstabilisation de l’État de droit et de nos démocraties européennes. Qui plus est, ce mouvement dépasse les frontières de l’Europe comme ont pu le démontrer les réactions de gouvernements étrangers. Il est par ailleurs essentiel de préciser que la décision a été rendue parce que le juge en a été saisi : ce dernier n’a pas agi de son plein gré contre le politique. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait déjà rendu une décision sur la même affaire en 2019 et la CJUE et le Parlement européen avaient envisagé, depuis 2017, de saisir les juridictions françaises. On ne peut donc soutenir qu’il s’agirait d’un règlement de compte entre juges et politiques.
A la suite de la publication de cette décision, de nombreuses attaques populistes et politiques sont survenues quant à la politisation des juges.
Jean-Jacques Urvoas, Professeur de droit public et ancien Garde des Sceaux, s’est saisi de ce débat selon lequel les juges seraient influencés par leurs opinions politiques lorsqu’ils rendent leurs décisions. Il a ainsi confirmé que les juges, comme tous les citoyens, ont des convictions politiques. Toutefois, il réfute l’idée d’une politisation des juges au travers de plusieurs arguments. Tout d’abord, un jugement est le produit d’un collectif et, dans le cas d’espèce, ce sont bien trois juges qui ont rendu ladite décision. Cette formation de jugement est protectrice pour le justiciable et permet de dégager une position de compromis. Ensuite, la syndicalisation des juges a été particulièrement visée au cours de plusieurs prises de parole et dans plusieurs articles sur le sujet. Or, tous les juges ne font pas partie du Syndicat de la magistrature (environ 30%). A ce titre, il est essentiel de rappeler que rien ne prouve que les juges ayant rendu le jugement de Madame Le Pen adhèrent effectivement à ce syndicat. En outre, la Constitution protège les juges par l’inamovibilité (article 64 de la Constitution). En ce sens, ils n’ont pas de hiérarchie, leur carrière dépend du Conseil Supérieur de la Magistrature et ils ne reçoivent de consignes ni de l’extérieur, ni de l’intérieur, ce qui leur permet d’être sereins lorsqu’ils jugent.
Dominique Lottin a quant à elle considéré que, si toute décision judiciaire peut donner lieu à des critiques, lorsque ces réactions sont virulentes et que les attaques prennent la forme de menace visant personnellement les magistrats en charge de juger et en charge desdits dossiers, ces menaces sont susceptibles de remettre en cause l’indépendance de l’autorité judiciaire (Article 64 de la Constitution). Dès lors que le juge subit des pressions et des intimidations, la question d’un jugement libre et serein peut se poser.
Jean-Jacques Urvoas rappelle que cette critique d’un gouvernement des juges, bien qu’elle soit traditionnelle, est en l’espèce, assez forte en raison du fait que l’inéligibilité soit assortie d’une exécution provisoire (article 471 du Code de procédure pénale) ayant pour conséquence de priver Marine Le Pen de ses chances d’accéder à l’élection présidentielle de 2027. La loi n° 2016-791 du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin II » a rendu obligatoire cette peine complémentaire pour les justiciables reconnus coupables d’un détournement de fonds publics. Le juge doit motiver dans sa décision les raisons pour lesquelles il n’infligerait pas cette peine au condamné. Cependant, cette réforme n’est pas applicable à cette affaire, car les faits sont antérieures à cette loi.
La peine d’inéligibilité correspond à une peine complémentaire de privation des droits civiques pour certains délits, notamment le détournement de fonds publics. Sur la motivation du caractère immédiat de la peine d’inéligibilité, la présidente du Tribunal correctionnel, Bénédicte de Perthuis, a déclaré que le tribunal avait pris en considération le risque de récidive et le trouble majeur à l’ordre public, c’est-à-dire le fait que soit candidate à l’élection présidentielle une personne condamnée en première instance.
En l’espèce, le délit de détournement public a pris fin juste avant l’entrée en vigueur de la loi Sapin II, or les juges ont considéré que le comportement de Marine Le Pen portait atteinte à l’ordre public démocratique et que le risque de récidive était trop élevé pour ne pas appliquer cette peine complémentaire. Par ailleurs, la peine aurait été la même pour n’importe quel autre justiciable placé dans une situation similaire conformément au principe d’égalité des citoyens devant la loi (article 6 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789). La position politique de Madame Le Pen ne doit pas conduire les juges à rendre une décision différente.
Le Professeur Philippe Blachèr (Université Lyon III) rappelle que l’accusée a initié un détournement de fonds publics au sein d’un système organisé durant plusieurs années (de 2004 à 2016 selon l’enquête réalisée). Ce détournement de fonds publics porte atteinte à la probité. Or les représentants doivent respecter la loi, surtout lorsqu’ils exercent une fonction de représentation et de mise en représentation (Loi Sapin II).
Le Professeur Jean-Philippe Derosier (Université de Lille) a ajouté que, dès lors que Madame Le Pen ne reconnaît pas le caractère pénal des faits (tout en ne les contestant pas eux-mêmes), rien ne permet d’assurer qu’elle ne reproduira pas le même système dans le cadre d’un autre mandat. Le risque de récidive existe. De surcroît, si elle était élue Présidente de la République, elle échapperait à la justice pendant la durée de son mandat, puisque l’article 67 de la Constitution confère une immunité (inviolabilité) au Président de la République en exercice.
Enfin, en tant que Présidente de la République, Madame Le Pen disposerait d’une position politique lui permettant de faire évoluer la législation pénale afin d’échapper à toute responsabilité, comme l’a fait, par exemple, l’ancien Premier Ministre italien Silvio Berlusconi.
Madame Le Pen a interjeté appel de ladite décision et envisage également d’introduire une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contre cette exécution provisoire.
Le Conseil constitutionnel a déjà rendu une décision QPC le 28 mars 2025 (n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025) concernant l’exécution provisoire à l’égard d’un élu municipal de Mayotte. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de la disposition au regard d’une réserve d’interprétation, en indiquant que cette exécution provisoire était conforme à la Constitution sous réserve qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’exercice d’un mandat en cours, ni à la liberté qu’ont les électeurs de choisir leurs élus (considérant 17).
Si le Conseil constitutionnel est le seul en mesure de prendre une position définitive sur la constitutionnalité de l’exécution provisoire, on pourrait considérer qu’il l’a fait à travers cette réserve d’interprétation, alors même que la question de constitutionnalité qui lui était posée ne portait pas directement sur l’article 471 du code de procédure pénale. La conséquence pourrait être qu’un renvoi ne serait plus possible, car la condition de non déclaration de conformité à la Constitution ne serait plus remplie.
Par ailleurs, il aura à fixer la liste des candidats à l’élection présidentielle. Si Marine Le Pen, malgré son inéligibilité provisoire, obtient les parrainages nécessaires, le Conseil constitutionnel statuera sur sa candidature. S’il refuse de l’enregistrer, elle pourra contester cette décision devant lui, en introduisant parallèlement une QPC. C’est peut-être le seul moyen, pour Marine Le Pen, d’obtenir que sa question soit examinée par le Conseil. Mais c’est à double tranchant : si elle était la seule candidate de son parti et que le Conseil ne lui donne pas raison, le Rassemblement national sera privé de toute candidature et, à l’inverse, si une autre candidature, « de secours », avait aussi obtenu les parrainages nécessaires et que le Conseil donne raison à Marine Le Pen, ce second candidat ne pourra pas se retirer et le Rassemblement national aura deux candidats.
Enfin, comment les juges pourraient-ils se soustraire à la volonté du peuple alors qu’ils n’ont fait qu’appliquer le droit et les conséquences qui en découlent ? Le Professeur Jean-Philippe Derosier a rappelé que la justice est rendue au nom du peuple et qu’il s’agit ainsi d’une justice démocratique. En outre, le peuple n’est pas juge et les juges, indépendants et impartiaux, suivent un raisonnement juridique, en vertu du droit et non en fonction de leurs convictions politiques.
Sur la priorisation du jugement en appel
Cette décision pourrait par ailleurs porter atteinte à la présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme) dès lors qu’un individu est empêché de concourir aux élections présidentielles alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive. A cet effet, les juges ont expressément indiqué que Madame Le Pen pourrait faire l’objet d’une condamnation définitive au regard des faits alors même que le jugement n’est pas définitif. Cette décision a donc des conséquences qui pourraient être irréversibles quant à la faculté de Madame Le Pen de se présenter à l’élection présidentielle.
Néanmoins, la Cour d’Appel de Paris a publié un communiqué après sollicitation expresse du Garde des Sceaux (qui ne peut pourtant pas intervenir dans des affaires individuelles), dans lequel elle a annoncé des délais de jugement restreint, indiquant à Marine Le Pen que la décision en appel serait rendue avant l’été 2026, soit avant l’élection présidentielle de 2027. Selon Dominique Lottin, cette rupture effective d’égalité s’explique donc en raison des enjeux de la décision. En effet, la Cour d’Appel de Paris a considéré qu’il convenait effectivement de prioriser cette affaire, au regard des conséquences que cette décision aura sur la prochaine élection présidentielle. Une telle priorisation n’est pas exceptionnelle ; en effet, l’insuffisance des moyens de la justice impose très souvent aux juridictions de fixer des calendriers d’audience différenciés selon les affaires.
Sur une potentielle suppression de l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité
Le député Eric Ciotti, a déposé une proposition de loi visant à supprimer l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité. Cette proposition de loi a vocation à interférer sur une affaire en cours. A chaque fois qu’une telle proposition a été introduite, ce fut à la suite de secousses politiques (comme ce fut le cas pour l’affaire Cahuzac qui a eu pour conséquence de créer la HATVP). Le texte sera examiné le 26 juin 2025. Si la loi est adoptée, elle serait de nature à s’appliquer à Marine Le Pen dès lors que les lois pénales plus douces sont rétroactives et s’appliquent aux affaires en cours (article L.122-1 du code pénal).
D’après Jean-Jacques Urvoas, pour la première fois, une affaire pourrait se traduire par une régression dans le domaine de l’éthique publique. Or l’inéligibilité s’inscrit dans un impératif d’exemplarité et de probité des élus et concourt donc à une démocratie saine. Les élus doivent montrer l’exemple et les deniers publics ne doivent pas servir des intérêts personnels.
En 1994, une proposition de loi (qui n’a jamais été votée) selon laquelle il faudrait un casier judiciaire vierge pour candidater à une élection fut proposée par la première Présidente de la Cour de cassation, Simone Rozès, afin de lutter contre la corruption. Le Sénat s’était opposé à cette proposition. L’idée a de nouveau émergé dans la loi Sapin II, mais elle n’a pas abouti et reste toujours en débat.
Beverley Toudic, post-doctorante en droit public (Université de Lille), a conclu les échanges en rappelant que l’Etat de droit et la démocratie ne doivent pas s’opposer mais bien se compléter puisque le cadre de l’Etat de droit garantit une démocratie saine et effective et que la démocratie, par le droit, vient protéger le citoyen d’éventuels abus de pouvoir de la part des gouvernants.
Ce procès illustre ainsi la difficulté de concilier les exigences de moralisation de la vie publique, les principes fondamentaux de l’État de droit et le respect de la démocratie.
(1) TJ Paris, 11e ch., 1re sect., 31 mars 2025, n° 15083000886