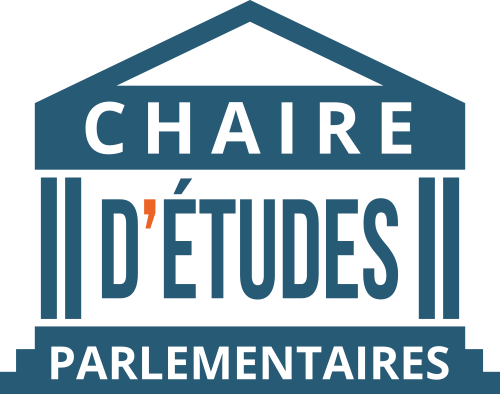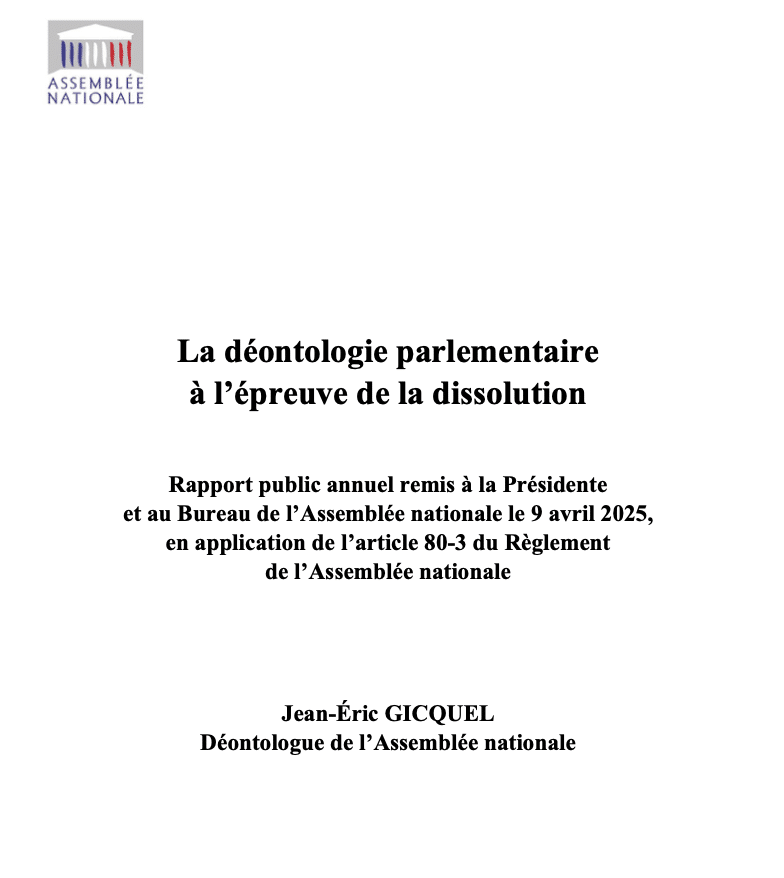Sur cette thématique, à lire en parallèle le billet de Philippe Blachèr sur Déontologie : HATVP et Déontologue de l’Assemblée nationale, à propos de deux nominations récentes
Sur un tempo prestissimo : l’activité du Déontologue de l’Assemblée nationale accélérée par la dissolution
Les évènements qui ouvrent la porte à un flot potentiellement illimité d’analyses, de spéculations et d’exégèses ne sont pas nombreux. Assurément, la dissolution de l’Assemblée nationale en est un. Nous savions déjà que ses secousses n’avaient épargné guère d’acteurs institutionnels. En lisant le rapport public pour l’année 2024 remis par le Déontologue de l’Assemblée nationale, le Professeur Jean-Eric Gicquel, nous comprenons que ses services, légitimement surpris par la fin brutale de la XVIe législature, n’ont pas été préservés, submergés qu’ils furent par un afflux inhabituel de sollicitations dès le 10 juin 2024. Cette surcharge soudaine de travail, dont l’ampleur semble visiblement inédite, a contraint le Déontologue à réaliser, loin du charivari médiatique estival et dans un temps exceptionnellement restreint, des consultations censées s’étirer sur l’ensemble de la législature. Surtout, cette décision a sonné le réveil d’un long sommeil léthargique où plus grand monde n’envisageait sérieusement qu’une législature ne puisse s’écouler jusqu’à son terme légal. Le Déontologue a donc été confronté à de multiples situations d’élus pris en étau entre l’assurance d’une fin immédiate de leur mandat, avec les innombrables obligations comptables et financières que cela implique, et le flou quant au sort à réserver à leurs engagements contractuels et aux dépenses déjà exposées, le tout dans une période contraignante de campagne électorale.
À ce contexte singulier s’ajoute une circonstance, et non des moindres, que le terme anticipé de la législature implique subséquemment la fin du mandat confié à son Déontologue. Le calendrier s’est donc accéléré pour cette « personnalité indépendante », présentée par la presse comme « ex-déontologue » dès juin 2024. Fort heureusement, les missions du Déontologue ne terminent qu’au terme d’un délai de six mois après la fin du mandat des députés, assurant une stabilité toute relative dans la crise qu’a traversé la chambre basse. Malgré ces circonstances inhabituelles, les chiffres de l’année 2024 sont éclairants quant à la confiance dont lui témoignent de plus en plus de députés. Avec une augmentation de 50% des réponses écrites par rapport à l’année 2023, qui était déjà le témoin d’une forte activité, environ 45% des députés ont sollicité le Déontologue au cours des six derniers mois de la XVIème législature, et 60% au cours du premier semestre de la suivante. Notons que les trois-quarts des consultations écrites concernent l’interprétation des règles encadrant l’utilisation des frais de mandat, signe d’un affermissement de la déontologie dans l’emploi des deniers publics, à rebours d’une tradition d’opacité de gestion des comptes des parlementaires. Jadis source de méfiance de députés jalousement attachés à leur souveraineté, il faut se réjouir que le Déontologue soit parvenu à devenir un acteur incontournable du paysage feutré de l’Assemblée nationale. Son avis est sollicité dans des domaines variés, pour des questions pointues et d’une très grande technicité, appelant souvent des raisonnements subtils. Le plan du rapport annuel 2024 fait état d’une activité inégalement soutenue du Déontologue, qui se traduit par une dominance des contrôles financiers et comptables, un recul résiduel de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêts et de la lutte contre les harcèlements ainsi que par un renforcement de la coopération internationale.
Presto : la place toujours prépondérante des contrôles financiers dans l’activité du Déontologue.
Ce ne sont pas moins de 190 députés qui furent tirés au sort pour faire l’objet d’une campagne de contrôle relatif à l’utilisation de l’AFM sur le deuxième semestre de l’année 2023. Cette première vague, qui n’a pas été impactée par la dissolution, s’est soldée par un bilan en demi-teinte, malgré des moyens humains et techniques visiblement satisfaisants. Le faible volume des recommandations émises par le Déontologue fut contrebalancé par un montant total des remboursements demandés analogue aux premières années où le contrôle fut mis en œuvre. Un recul, donc. Sans rentrer dans l’ensemble des détails techniques liés à la déontologie de la comptabilité parlementaire, quelque peu byzantine, quelques obligations qui pèsent sur les députés méritent d’être mises en avant. En premier lieu, celle qui consiste à transmettre les relevés bancaires du compte AFM pour l’année civile précédente, à laquelle seuls deux députés n’ont pas satisfait. Ensuite, une nouvelle obligation leur impose de déposer une synthèse des dépenses imputées sur leur compte AFM pour l’année écoulée. Une simple formalité, peu chronophage selon le Déontologue, à laquelle l’écrasante majorité des députés s’est pliée volontairement. Il est à noter que la rigueur des dossiers transmis par les députés et leurs experts-comptables est hétérogène, ce qui pourrait être corrigé par une harmonisation doublée d’une simplification de la méthodologie appliquée et des tableaux de présentation des dépenses, à l’instar de la pratique sénatoriale. Une réforme des relations avec les experts-comptables est souhaitée, en recentrant leurs missions à la tenue d’un journal de banque corrélé à un rapprochement bancaire et à la vérification d’un justificatif pour chaque opération. Un seul député s’est soustrait de manière réitérée à la procédure de contrôle, avant que la délégation du Bureau chargée de la transparence et des représentants d’intérêts confirme la demande de remboursement de l’AFM décidée par le Déontologue. À ceux qui seraient tentés de présenter le Déontologue comme un simple organe de conseil dépourvu de tout pouvoir coercitif, cet exemple montre que l’arsenal juridique actuel lui permet, dans les faits, d’inciter les autorités à enclencher des poursuites disciplinaires.
Plus largement, une simplification de la gestion comptable semble opportune, compte tenu du flux des opérations qui transitent sur le compte AFM et des inexactitudes inévitables constatées dans l’enregistrement des dépenses : dépassement du crédit collaborateur, cotisations de groupe, frais imputables à la dotation matérielle du député (DMD), etc. Il est à souligner l’exemple d’un député qui fit les frais, si l’on puit dire ainsi, de la rigidité des règles de mouvements entre le compte AFM et son compte personnel. En effet, une avance de fonds au moyen de deniers personnels pour financer son mandat, fût-elle importante, ne peut être remboursée que dans la limite du solde AFM disponible et avant la déclaration du solde. Cette règle, habituellement sans incidence, frappe sévèrement l’élu concerné lorsque la durée d’amortissement de l’investissement, calquée sur la durée légale et espérée du mandat parlementaire, est brutalement interrompue en cas de dissolution. En outre, comme chaque année, le Déontologue a effectué des recommandations relatives aux conditions d’application du barème des indemnités kilométriques et, de manière inédite, sur les modalités de prise en charge des déplacements réguliers d’un collaborateur parlementaire entre la circonscription et Paris. À ce sujet, il invite les députés à enregistrer deux lieux de travail sur le contrat puis à solliciter le remboursement des abonnements.
Cette campagne a suscité de multiples questions pécuniaires, dont celle de l’inéligibilité au remboursement des dépenses dépourvues de justificatif et de justification circonstanciée, des « goodies » distribués dans l’espace public ou encore des frais d’entretien du pied-à-terre francilien. Dans la même veine, le Déontologue a rappelé que les documents parlementaires dont les frais de conception, d’impression et de distribution sont susceptibles d’être financés par les frais de mandat, doivent s’abstenir de promouvoir toute candidature à une élection. La campagne fut aussi l’occasion de se positionner sur l’impossibilité d’imputer sur l’AFM les frais de justice sans lien suffisamment établi avec le mandat parlementaire, ainsi que les dépenses déraisonnables liées à la rémunération des « chasseurs de têtes », des artistes et divers intervenants pour participer à des fêtes populaires, des accessoires des drapeaux officiels ou encore de matériel photographique. Notons enfin la mise en œuvre de trois contrôles spéciaux, liés à des opérations suspectes sur le compte AFM, parfois préjudiciables à l’honorabilité et à la réputation de la Représentation nationale. Citons, pêle-mêle, les frais de gardiennage de chiens, d’abonnement à des sites de rencontres, et des retraits d’espèces ayant servi à financer l’achat de produits stupéfiants.
À cet égard, le Déontologue suggère, dans la lignée de ses prédécesseurs, d’inscrire un principe de dignité dans le code de déontologie du député. L’idée vise à répondre à une aspiration légitime : poursuivre et sanctionner les députés dont le comportement jetterait le doute voire le discrédit sur l’institution. La pertinence de cet objectif ne doit pas jeter un voile sur les risques que la mesure est susceptible de provoquer et qu’il conviendrait de développer plus longuement. L’affirmation de grandes notions éthiques, parfois fourre-tout, souvent subjectives, est une gageure à appliquer à des situations d’espèce, surtout lorsque les faits reprochés ont été commis dans la sphère privée. Bien des observateurs ont constaté l’imprévisibilité de la jurisprudence en la matière. De surcroît, si les avocats sont soumis à une kyrielle d’exigences morales que le Déontologue rapproche de celles des parlementaires, les sanctions disciplinaires dont ils sont frappés peuvent toujours faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par le juge d’appel, puis de cassation. Or l’accès au juge est dénié aux parlementaires. Bien entendu, l’absence d’un droit au recours juridictionnel n’est pas, en lui-même, un obstacle à l’affirmation d’une exigence déontologique, surtout lorsqu’elle existe déjà implicitement. Mais il nous semble que cette circonstance doit conduire à une certaine prudence dans la réflexion et à une grande précision dans la rédaction de la formule.
Cette mission achevée, la dissolution a nécessité la mise en œuvre d’une nouvelle campagne de contrôle des soldes de l’AFM versée sur l’ensemble de la législature, soit un total de 600 dossiers instruits, impliquant un travail qui s’est exceptionnellement conduit jusqu’au début de l’année 2025.
Avec une consommation plus faible que la législature antérieure – et pour cause, le mandat a été amputé de trois années – plus de 80% des députés ont déclaré un solde AFM positif, avec un reversement évalué à hauteur de 5,6 millions d’euros. L’obligation déclarative a, dans l’ensemble, été respectée, malgré quelques retards qui perturbent les opérations du Déontologue, lequel appelle à davantage de fermeté dans la répression des comportements dilatoires. Malgré le respect de cette obligation, plus de 300 députés firent l’objet de demandes de renseignements complémentaires. En dépit de quelques exceptions, les demandes de reversement résultent, pour la plupart, d’erreurs de calculs et non d’une volonté d’abuser de l’utilisation des frais de mandat, et sont globalement respectées par les concernés. Le retour d’expérience de ces deux campagnes conduit le Déontologue à suggérer un assouplissement global du régime des dépenses de fin de mandat. Il propose aussi que les députés réélus qui ont déclaré un solde négatif soient contraints de réabonder le compte bancaire AFM avec des fonds personnels lorsqu’ils conservent le même compte bancaire AFM pour le mandat suivant.
Il faut relever que plusieurs députés se sont retrouvés dans une situation financière personnelle délicate, faute de prudence dans la conclusion de contrats durant l’exercice de leur mandat. Le Déontologue recommande de constituer un fonds de roulement suffisant et d’être particulièrement attentif aux stipulations contractuelles. La résiliation anticipée des contrats de louage de véhicules (LOA et LDD) ou encore des baux conclus pour installer les permanences, fixes ou mobiles selon la tendance, a pu générer des situations inextricables, impliquant parfois qu’une partie du coût soit personnellement supporté par l’élu. L’utilisation des frais de mandat en période de campagne électorale a généré de nombreuses interrogations, notamment sur le financement de communications civiques et apartisanes incitant les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales et sur l’impossibilité de convertir les dépenses engagées dans l’exercice du mandat (par exemple, une lettre parlementaire et l’organisation d’un repas champêtre) en dépense électorale. S’est aussi posée la question des dépenses du candidat victorieux, qui n’est pas autorisé à remercier les électeurs sur les deniers de l’Assemblée. Le Déontologue a également appelé les députés à une grande vigilance sur le recours aux enquêtes d’opinions et aux sondages financés par l’AFM en période électorale. Il a également précisé que l’AFM ne pouvait pas être utilisée pour externaliser les tâches de collaborateur parlementaire « ni, plus largement, les missions constitutionnelles des députés », face à la tentation de certains élus de recourir à des prestataires externes pour réaliser des missions ponctuelles, notamment la rédaction d’amendements. Notons au surplus, l’abondance des questions et la subtilité des réponses apportées en matière de frais de réception, de représentation et d’emploi de personnels de service : garde d’enfants et même recours malvenu à un détective privé pur surveiller un collaborateur parlementaire. Certaines dépenses mixtes, c’est-à-dire partiellement liées au mandat parlementaire et quelques fois en lien avec une propagande partisane, donnent lieu à une analyse d’une particulière technicité.
Rallentando : la gestion des conflits d’intérêts
Malgré une baisse significative des déclarations – obligatoires – relatives aux invitations à des voyages financés partiellement ou intégralement par des tiers, le Déontologue a été amené à rappeler aux représentants d’intérêts les diverses règles de transparence. Un effort doit être poursuivi en matière de déclaration de dons et d’invitations des évènements sportifs. Un contexte doublement singulier l’a incité à faire preuve d’une vigilance accrue : les Jeux olympiques et Paralympiques ainsi que l’intensification des missions de contrôle du Parlement dans un contexte d’instabilité gouvernementale et de créations de plusieurs commissions d’enquêtes parlementaires. Eu égard à l’ampleur de l’évènement, le nombre de déclarations d’invitations, quatorze, inférieur à celui de la Coupe du monde de rugby, semble dérisoire.
Concernant les représentants d’intérêts, le Déontologue a dû les rappeler à leur obligation d’informer par écrit les députés de la valeur des avantages proposés, ainsi qu’à l’interdiction de fournir des informations erronées pour tenter de peser sur les décisions des élus et d’utiliser les locaux du Parlement afin de promouvoir leurs intérêts. Toujours en matière de conflits d’intérêts, une grande partie de l’activité du Déontologue réside dans leur prévention, par le biais de consultations à destination des élus, de leurs collaborateurs et des agents publics. Les députés, régulièrement approchés pour des entretiens rémunérés, peuvent aussi se retrouver dans une position délicate dans le cadre de leurs missions constitutionnelles : les fonctions de rapporteur et même de membre d’une mission d’information ou d’une commission d’enquête, ou la participation à une procédure de nomination peuvent, selon la nature et l’intensité des intérêts privés en jeu, poser des difficultés éthiques. Les activités associatives, professionnelles et les mandats locaux du député, comme ceux de ses proches, conduisent régulièrement le Déontologue à suggérer d’effectuer a minima une déclaration orale d’intérêts. L’appareil administratif de l’Assemblée nationale est lui aussi soumis, lors des mobilités entrantes et sortantes, à un avis du Déontologue. Son office consiste ici à vérifier que les missions ambitionnées soient essentiellement administratives et techniques et que le positionnement hiérarchique n’implique pas d’être en relation directe avec des députés pour traiter de questions en lien avec les fonctions jusqu’alors occupées. Sur cette base, une seule réserve a été émise, à l’égard d’un fonctionnaire susceptible, dans ses futures missions d’auditeur au Conseil d’Etat, de se prononcer sur une demande d’avis de l’Assemblée nationale. Puisque la tâche du Déontologue s’apparente parfois à celle de Pénélope, le rapport pour 2024 propose, une nouvelle fois, d’adopter une charte de déontologie du personnel.
Moderato : l’intervention restreinte dans les situations de suspicion de harcèlement.
Depuis 2020, une cellule « anti-harcèlement » a été créée au sein de l’Assemblée nationale, à destination des députés, de leurs collaborateurs, des agents publics et de leurs stagiaires respectifs. Ce dispositif externalisé, constitué de juristes et de psychologues, peut procéder à un signalement auprès du Déontologue, lequel pourra diligenter une enquête interne qui sera confiée au prestataire externe. Visiblement, le nombre de plaintes auprès de la cellule d’écoute permanente s’est largement tari au cours de l’année 2023, diminution qui s’expliquerait par les délais de reconstitution des équipes après les élections législatives. Il faut dire aussi que la fin du mandat parlementaire entraine, de fait, l’arrêt des investigations par la cellule dédiée, ce qui n’empêche pas une mise en contact avec des avocats. Les situations de souffrance au travail chez le personnel et les stagiaires des services de l’Assemblée nationale constituent une large partie des plaintes.
Allegro : le renforcement de la coopération internationale du Déontologue
De nombreux chantiers ont été menés par le Déontologue au sein du réseau francophone d’éthique et de déontologie parlementaire, avec notamment l’élaboration d’un code d’éthique et de déontologie pour l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, la création d’une bourse de recherche attribuée à un doctorant en droit dont les travaux de recherche portent sur la façon dont le droit public mobilise le concept d’intégrité ainsi que la publication d’un guide des bonnes pratiques. En outre, le Déontologue a été amené à exposer ses attributions à des délégations étrangères invitées à l’Assemblée nationale.
En définitive, l’année 2024 a été tout à la fois exceptionnelle et normale. Nombre de missions traditionnelles du Déontologue ont été menées à bien sans être excessivement perturbées par les circonvolutions politiques. À côté de cela, l’épreuve de la dissolution a révélé l’inadéquation de certaines règles et la nécessité d’en simplifier d’autres. Parmi les recommandations du Déontologue, il en est une qui nous semble mériter une publicité particulière : celle qui vise à décorréler la durée de son mandat de celle des députés. En effet, les modalités du mandat, fixées par l’article 80-2 du Règlement de l’Assemblée nationale, prévoient que ses missions prennent fin six mois après le début de la législature suivante. Il est donc, comme les députés, soumis au fait du Prince et chargé – ce qui convient à chacun – d’assurer l’intérim durant un semestre. Théoriquement, l’Assemblée nationale peut changer de Déontologue autant de fois que le président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale. En exposant inutilement le Déontologue aux aléas politiques, le législateur le fragilise et prive cette institution de ce qui fait la force de l’administration parlementaire : une stabilité puisée de son inamovibilité. Le Parlement a besoin, qui plus est dans une forte période de crise politique, de s’appuyer sur une administration solide et sur un Déontologue tout entier occupé à sa tâche, qui mène une action sur le temps long. Placer le Déontologue à l’abri du rappel aux urnes permettrait de mieux anticiper et de planifier les risques déontologiques, et ainsi d’apporter une sérénité souhaitable, tant pour les parlementaires que pour les fonctionnaires de son service. Aujourd’hui, alors que les chances que la législature actuelle aille jusqu’à son terme légal sont particulièrement maigres, une révision de cette disposition semble s’imposer.
Au-delà de cette proposition, la plume de Monsieur Gicquel laisse transparaître parfois, avec toute la retenue qu’exige sa fonction, une critique non moins acérée des subtilités parfois kafkaïennes de la déontologie parlementaire. Si la moralisation de la vie publique a pris un formidable contre-pied à une tradition séculaire de discrétion, il existe un risque d’excès de transparence via une surenchère permanente de règles et d’exceptions parfois absconses. L’aspect visiblement banal de certaines questions interroge sur le risque d’emprise de la science déontologique sur le quotidien de députés qu’il ne faudrait pas condamner à une inertie logistique et financière. Sans jeter l’anathème sur des règles qui poursuivent un objectif louable, l’on peut se demander si les députés ne paieraient pas, notamment par rapport à leurs collègues sénateurs, un tribut un peu lourd à la déontologie. Certaines règles sont de véritables lits de Procuste qui, s’ils ne font pas l’objet d’une simplification, pourraient finir par exaspérer les principaux concernés. Or, souveraineté parlementaire oblige, ce sont les députés qui tiennent la plume de leur propre Règlement. Le tact dans l’audace, selon Cocteau, n’est-ce pas de savoir jusqu’où on peut aller trop loin ?