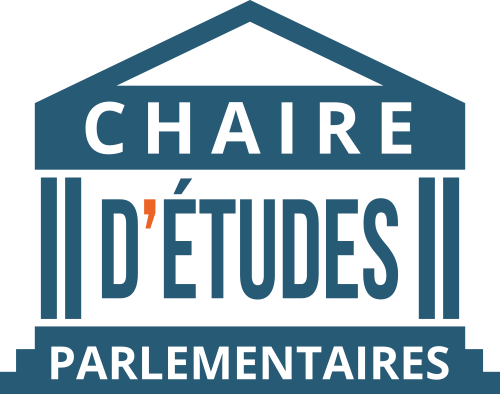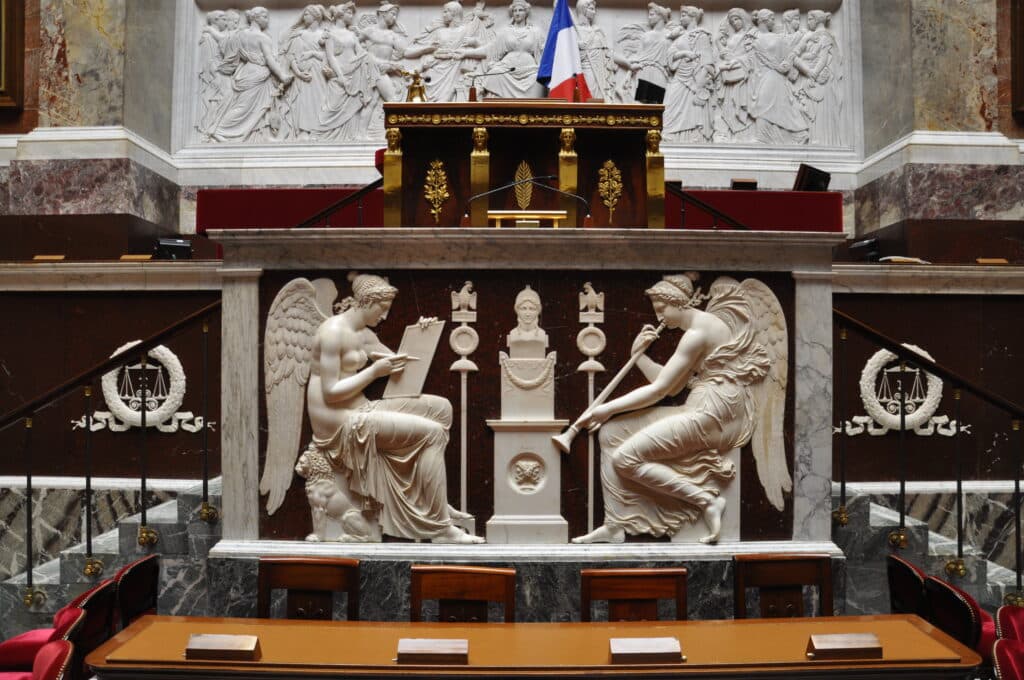Comme le prévoient les textes, l’ouverture de la session ordinaire, le 1er et 2 octobre 2025, a débuté par l’élection pour le renouvellement du Bureau de l’Assemblée nationale. Cette instance collégiale, qui exerce l’autorité sur les services, qui gère l’organisation des travaux parlementaires et fixe les sanctions disciplinaires les plus hautes infligées aux députés, joue un rôle central au Palais Bourbon. Elle se compose de la Présidente (qui n’est pas concernée par le renouvellement), de six vice-présidents, de trois questeurs et de douze secrétaires.
Evènement normal qui rythme, chaque année, la rentrée parlementaire, le procédé de désignation des membres du Bureau ne se déroule plus, depuis 2022, selon les règles du consensus entre les groupes politiques. La courtoisie républicaine invitait traditionnellement chaque groupe à proposer des noms à la présidence de façon à permettre à tous d’être représentés au prorata des effectifs tout en évitant d’exclure une formation importante dans les fonctions de direction. A cet effet, le système prévu par l’article 10 du RAN s’inscrit dans cette logique : « L’élection des viceprésidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes ». Pour atteindre cet objectif, le Règlement prévoit une répartition par points censé réguler, de façon équitable, les responsabilités entre les groupes. Ce système ne peut s’appliquer qu’en cas d’accord entre les groupes. Toutefois, « Si le Président constate qu’il n’y a pas d’accord » (art.10 RAN), il y a lieu d’organiser une élection qui se déroule à la majorité absolue puis, en cas de troisième tour nécessaire, à la majorité relative.
La configuration particulièrement éclatée – avec trois blocs non homogènes et un nombre record de onze groupes depuis 2024 – n’est visiblement plus de nature à permettre de trouver des compromis pour une répartition homogène (et paritaire) des postes à responsabilité entre les députés. Le précédent renouvellement avait déjà révélé les tensions très vives entre élus, y compris au sein de la « coalition gouvernementale ». Trois tours, marqués par des irrégularités (pour l’élection à la vice-présidence) et des tractations de couloirs de dernière minute, avaient conduit à exclure la présence en Bureau de tout membre du groupe Rassemblement National et ses alliés dont les effectifs totalisent 142 députés (voir le billet de Gilles Toulemonde). Cette année, l’affaire a été pliée en quelques minutes. Un seul tour a permis de dégager une majorité absolue – pour les vice-présidences, le 1er octobre et pour les secrétaires, le 2 octobre – en faveur de candidats d’un « socle commun » fondé sur une entente entre quatre groupes du bloc supposé soutenir le futur Gouvernement de Sébastien Lecornu (s’il voit jamais le jour : Ensemble pour la République, Horizon et indépendants, Modem, Droite républicaine LR). Cette stratégie d’alliance a bénéficié aux membres du groupe Rassemblement National : en votant en faveur des candidats du « socle commun » et en renonçant à présenter des candidats pour présider une commission (donnant ainsi un avantage aux candidats du « socle commun » contre les candidats du bloc de gauche), ils ont, en retour, pu bénéficier des voix des députés du bloc central pour revenir au Bureau (avec cinq membres dont deux vice-présidents). La gauche n’y est plus majoritaire (elle compte désormais sept sièges contre douze précédemment) tandis que le « socle commun » retrouve, avec neuf représentants au Bureau et toutes les présidences de Commission (à l’exception de la commission des Finances) une position prééminente (mais pas majoritaire) au Palais Bourbon.
« Le jeu du Règlement » arrange, pour cette fois, certains élus au détriment de ceux qui se réjouissaient l’année dernière à leur place. Mais ces « règlements de comptes » au Palais Bourbon confirment que les usages consensuels sous l’égide du fait majoritaire sont révolus, sans garantir que ces nouvelles pratiques enorgueillissent l’institution parlementaire