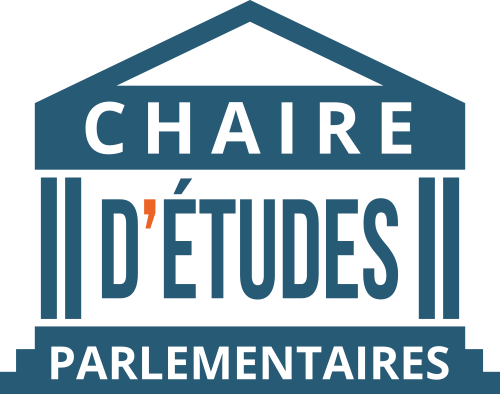L’élection présidentielle polonaise a eu lieu les 18 mai et 1er juin 2025. Karol Nawrocki, candidat officiellement mais soutenu par le PiS, principal parti d’opposition, l’a emporté de justesse face au candidat de la majorité, soutenu par le Premier ministre, Donald Tusk. Le Professeur Katarzyna Kubuj, de l’Institut des Sciences juridiques de l’Académie polonaise des Sciences et le Sénateur Kazimierz Ujazdowski nous livrent un regard croisé sur ce processus électoral, quant à ses implications juridiques et politiques, qui pourraient être lourdes de conséquences pour l’avenir, en particulier d’ici aux élections législatives de 2027.
Le regard académique de Katarzyna Kubuj
Les élections présidentielles qui ont eu lieu le 18 mai 2025 (premier tour) et le 1er juin 2025 (second tour) ont été organisées pour la sixième fois en vertu de la Constitution du 2 avril 1997, et pour la huitième depuis la transformation politique de 1989. Karol Nawrocki l’a emporté avec une légère avance : au second tour, il a obtenu 50,89 % des voix et l’écart avec Rafał Trzaskowski, le candidat du parti du Premier ministre Donald Tusk, était de 369 451 voix. Nawrocki était officiellement un candidat indépendant, mais représentait de facto le parti Droit et Justice, PiS, qui est actuellement un parti d’opposition, mais qui était au pouvoir de 2015 à 2023.
De iure
En vertu de la Constitution de 1997, le Président de la République de Pologne est élu par la Nation au suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret (art. 127). Le droit d’élire le Président de la République est acquis à tout citoyen polonais ayant dix-huit ans accomplis au plus tard le jour du vote et jouissant des pleins droits civiques. Tout citoyen polonais ayant trente-cinq ans accomplis au plus tard le jour des élections et jouissant des pleins droits électoraux aux élections au Sejm (l’Assemblée nationale polonaise) peut être élu Président de la République. Tout candidat doit être présenté par au moins cent mille citoyens jouissant du droit de vote au Sejm. Cette fois encore, les élections ont confirmé que cette exigence est discutable. En effet, elle permet l’accès à des personnes dont le soutien national est négligeable d’être candidats. Treize candidats ont été enregistrés en 2025 et pas moins de trois d’entre eux n’ont pas atteint la barre des cent mille voix au premier tour.
La Constitution prévoit que le Président de la République doit être élu à la majorité absolue des suffrages exprimés (ce fut le cas de la présidentielle de 2000), sans préciser les conditions concernant la participation. Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour, il est procédé, quatorze jours plus tard, à un second tour (art. 127 al. 4). Au second tour, ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Est élu Président de la République le candidat ayant recueilli au second tour le plus grand nombre de suffrages exprimés (art. 127 al. 6 ; c’était le cas en 2005, 2010, 2015, 2020, 2025). Si l’un des candidats retire sa candidature, est déchu du droit de vote ou décède, le candidat qui a recueilli successivement le plus grand nombre de suffrages au premier tour est admis au second tour. Dans ce cas, la date du second tour de scrutin est reportée de quatorze jours (art. 127 al. 5).
De facto
Les élections de 2025 ont été accompagnées de tensions politiques particulières dues à la crise politique et constitutionnelle qui dure depuis dix ans. En 2015, l’élection présidentielle a d’abord été remportée par le candidat du parti Droit et Justice (réélu en 2020), puis cette formation (conservatrice, avec des traits populistes), associée à de plus petits partis de coalition, a obtenu la majorité absolue des sièges au Sejm, ce qui lui a permis d’exercer un pouvoir presque illimité (après l’élection de 2019, l’opposition a pris un léger avantage au Sénat, ce qui n’a que peu entravé les actions de la majorité au pouvoir). Cette situation a duré jusqu’en 2023, lorsque les partis d’opposition de l’époque sont sortis de l’impasse et ont battu Droit et Justice aux élections législatives.
La période comprise entre 2015 et 2023 a donné lieu à d’importants changements systémiques, au renforcement de l’exécutif et à la subordination de nombreuses institutions de l’État aux représentants d’un seul parti politique. Un certain nombre de réformes controversées ont été menées, en particulier dans le domaine judiciaire, ce qui a entraîné la politisation du Tribunal constitutionnel et, en partie, de la Cour suprême. Le mandat du Conseil national de la magistrature a été raccourci et l’élection de ses nouveaux membres a été jugée anticonstitutionnelle. Cette situation a eu un certain nombre de conséquences négatives pour le système judiciaire dans son ensemble. Les nominations de juges, examinées par le nouveau Conseil national de la magistrature, sont considérées, d’un point de vue juridique, comme entachées d’irrégularités, en ne répondant pas au critère d’indépendance. De nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne l’ont confirmé. Les processus de prise de contrôle des segments successifs du gouvernement se sont accompagnés d’une politisation des médias publics.
L’arrivée au pouvoir en 2023 d’une nouvelle coalition, dirigée par Donald Tusk, laissait espérer un renversement des effets des réformes antérieures et un retour à l’État de droit, notamment au sein du système judiciaire, ainsi que la mise en œuvre d’autres changements (comme la libéralisation de la loi sur l’avortement, fortement durcie par le gouvernement Droit et Justice et le Tribunal constitutionnel qui lui était favorable). Cependant, des amendements aux lois sont nécessaires pour y parvenir.
Contrairement aux sondages d’opinion et aux prévisions de Donald Tusk, le candidat qu’il soutenait n’a pas obtenu un soutien suffisant. Plusieurs facteurs l’expliquent, parmi lesquels un découragement face à la politique des partis traditionnels et un soutien important et inquiétant pour les partis d’extrême droite, en particulier parmi les jeunes électeurs (le candidat du parti de la Confédération a reçu au premier tour le soutien de 36 % des électeurs âgés de 18 à 30 ans, dont la plupart ont voté au second tour pour le candidat conservateur). Peu après les élections, Donald Tusk a demandé au Sejm d’accorder un vote de confiance au Conseil des ministres, ce qu’il a obtenu malgré les tensions internes à la coalition.
Après les élections présidentielles, nous nous trouvons dans une situation où les partis de la coalition formant le gouvernement Tusk disposent d’une majorité au parlement, où le président représentant l’opposition termine son mandat et où le président élu lui succèdera, en appartenant au même courant politique. Ainsi, une sorte de « cohabitation » (qui n’est pas équivalente à la cohabitation française) persistera, de sorte qu’il ne faut pas s’attendre à ce que l’on sorte de l’impasse et à ce que des changements systémiques significatifs soient apportés, comme l’espèrent le Premier ministre, les partis de la coalition au pouvoir et une partie importante de la société. Le Président, bien qu’il ne dispose pas de pouvoirs aussi importants que le Président de la Ve République, a néanmoins les moyens de bloquer les actions des opposants. Le Président encore en exercice, Andrzej Duda, en a fait usage à de nombreuses reprises, en refusant de signer des lois ou en les renvoyant au Tribunal constitutionnel, lequel favorise le parti Droit et Justice et rend des arrêts conformes à ses besoins.
Les élections présidentielles souffrent d’un autre défaut majeur. En Pologne, la validité des élections est déterminée par la Cour suprême. En raison des changements législatifs intervenus après 2015 au sein du système judiciaire, la chambre habilitée à statuer sur la validité des élections n’est pas une chambre indépendante au regard des normes européennes. Malgré des tentatives, il n’a pas été possible de modifier la situation juridique et de revenir à des solutions qui ne soient pas juridiquement contestables. La résolution sur la validité des élections a été adoptée le 1er juillet 2025 par la Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, dont le statut est contesté. Cette résolution a été précédée de l’examen des protestations électorales auxquelles les électeurs et les comités électoraux avaient droit (quelque 50 000 ont été reçues, dont beaucoup ont été renvoyées pour examen conjoint, ce qui a également soulevé des doutes, notamment auprès du procureur général). Les problèmes liés à la décision de la Cour suprême impliquent des doutes sur le statut du président élu qui, selon certains, ne devrait pas être autorisé à prêter serment et à assumer son mandat avant que la situation de la Cour suprême ne soit réglée. Selon d’autres, la présomption de validité de l’élection s’applique, aucune irrégularité électorale flagrante n’a été constatée et le président élu peut prêter serment. C’est la position adoptée par le président du Sejm lorsqu’il a annoncé la convocation de l’Assemblée nationale le 6 août 2025.
Les problèmes politiques en Pologne, qui ont surgi après 2015, n’ont pas perdu de leur importance. La perspective de réformes, rétablissant la forme des institutions conformément aux exigences du droit européen, s’est considérablement éloignée. Il est difficile de déduire des annonces du Président élu qu’il y aura une évolution du conflit entre les partis politiques au pouvoir. Les élections législatives auront lieu en 2027 et, si la coalition actuellement au pouvoir obtient la majorité, ce qui est difficile à prévoir deux ans auparavant, l’état de stagnation et d’impuissance se poursuivra. Si un parti ou une coalition soutenant le Président l’emporte, l’État de droit contesté se perpétuera, contrairement à la position des instances judiciaires européennes.
Le regard sénatorial de Kazimierz Ujazdowski
La victoire de Karol Nawrocki aux élections présidentielles a un double sens : sur le plan politique, elle marque le début d’une rivalité « équilibrée » avec la possibilité d’un changement de majorité gouvernementale en 2027. Sur le plan constitutionnel, elle comporte le risque d’un blocage de l’État en raison d’un conflit inévitable entre le nouveau Président et le Gouvernement de Donald Tusk. En politique, plus que dans d’autres domaines, l’analyse critique de ses propres erreurs est une condition indispensable à la réussite. Ce n’est pas le PiS qui a remporté les élections, mais le camp au pouvoir qui les a perdues en raison d’une stratégie erronée et d’une méthode politique inappropriée.
Deux facteurs ont joué un rôle fondamental. Premièrement, le Premier ministre Tusk a formé un gouvernement sans personnalités, avec une faible participation de ministres ayant leur propre agenda (Radosław Sikorski, Ministre des affaires étrangères, est certainement une exception positive) et leur propre ambition. À titre de comparaison, chaque gouvernement formé par le président Macron compte de nombreux politiciens dotés d’un solide profil technique. Le risque d’un exercice « solitaire » du pouvoir a été évoqué depuis longtemps. Un chef de gouvernement fort est un atout, mais à condition qu’il s’entoure des meilleures forces de sa propre coalition. L’absence de cette condition se traduit par une faible efficacité du gouvernement, ressentie par la majorité de la population, en particulier par les jeunes générations. Aux yeux des jeunes, le gouvernement est anachronique et concentré non pas sur la réalité, mais sur de vieilles querelles. On peut dire que les poursuites contre la corruption du PiS sont bruyantes et inefficaces. Il n’est donc pas surprenant que la Confédération (extrême droite) et le parti Razem soient si populaires dans cette partie de notre société (36,1 % des voix pour la Confédération et 18,7 % pour le parti Razem dans la tranche d’âge 18-29 ans). La règle est toujours la même : plus les partis traditionnels sont sclérosés, plus les partis protestataires sont forts.
Le deuxième élément est l’occasion manquée de rétablir la paix sociale après les élections de 2023. Le PiS a suscité l’opposition de l’opinion publique en raison de la division drastique de la communauté politique. Les électeurs du centre, dont le vote est particulièrement important pour le verdict final, espéraient que la coalition des partis vainqueurs instaurerait la paix sociale. Il faut dire qu’une grande partie d’entre eux a été rejetée par le camp au pouvoir en raison d’expériences idéologiques dans le domaine de l’éducation et d’actions qui ont montré une intolérance envers les croyants. Ajoutons que l’absence d’actions dans le domaine de la politique mémorielle, pratiquée pourtant par presque tous les États européens, n’a fait que renforcer les processus négatifs. Le vice-premier ministre Władysław Kosiniak-Kamysz a déployé des efforts pour mettre fin à ces pratiques, mais il était seul au sein de la coalition. Le problème n’est donc pas le manque de loyauté au sein de la coalition, mais son orientation fondamentale. Si le gouvernement n’est pas radicalement renforcé, avec un changement de stratégie et l’intégration d’une sensibilité de centre-droit, la probabilité d’un changement de pouvoir en 2027 sera élevée. De temps à autre, l’idée est exprimée qu’il serait possible de moderniser le camp au pouvoir en l’uniformisant et en disciplinant ses alliés. Si cette idée était mise en œuvre, elle ne conduirait pas à un assainissement de la coalition, mais à son affaiblissement.
Les élections ont pour effet de prolonger la cohabitation, c’est-à-dire la tension permanente entre les deux segments du pouvoir exécutif. Contrairement aux spéculations, la coalition au pouvoir ne se désagrègera pas et conservera sa structure actuelle, avec l’existence de la Troisième Voie et de la Gauche. Nous allons donc connaître une période de conflit institutionnel aigu entre le Président et le Gouvernement. Le défaut du système politique polonais réside dans le fait que, contrairement à la France, le Président, qui ne dispose pas d’instruments de gouvernement, possède des outils pour entraver l’action du gouvernement, à commencer par le droit de veto sur les lois. Il faut s’attendre à ce qu’il les utilise dans toutes les questions politiquement importantes, comme, par exemple, pour empêcher l’assainissement du pouvoir judiciaire et maintenir en vie la Cour constitutionnelle en tant qu’institution dépendante du PiS.
Il est dans l’intérêt stratégique de la Pologne de maintenir un minimum de cohérence dans sa politique de sécurité. La position internationale forte de la Pologne résulte de son opposition sans équivoque à l’impérialisme de Poutine et de ses efforts militaires supérieurs à la moyenne. Si la « guerre au sommet » s’étend à ce domaine, le prestige de la Pologne et nos capacités diplomatiques s’effondreront rapidement. C’est au Président Karol Nawrocki, nouvellement élu, qu’il appartient de définir ces relations de manière à ne pas compromettre le potentiel de sécurité de la Pologne. Le Ministre de la Défense, M. Kosiniak-Kamysz, a prouvé qu’il traitait la politique de défense avec la plus grande responsabilité.
Les élections présidentielles ont démontré la grande force de l’opinion publique indépendante et l’importance croissante des nouveaux médias, qui constituent, en particulier pour la jeune génération, un outil de contrôle du pouvoir. On peut espérer que ce nouveau facteur empêchera la rivalité politique de nuire aux intérêts stratégiques de la Pologne.