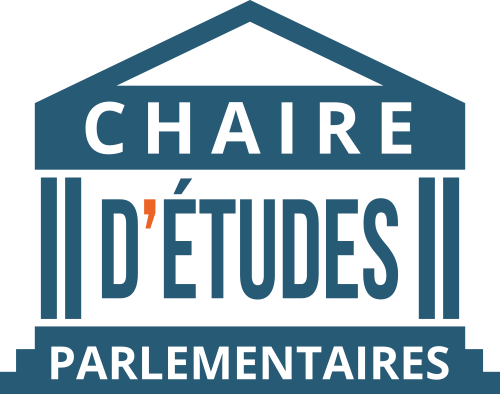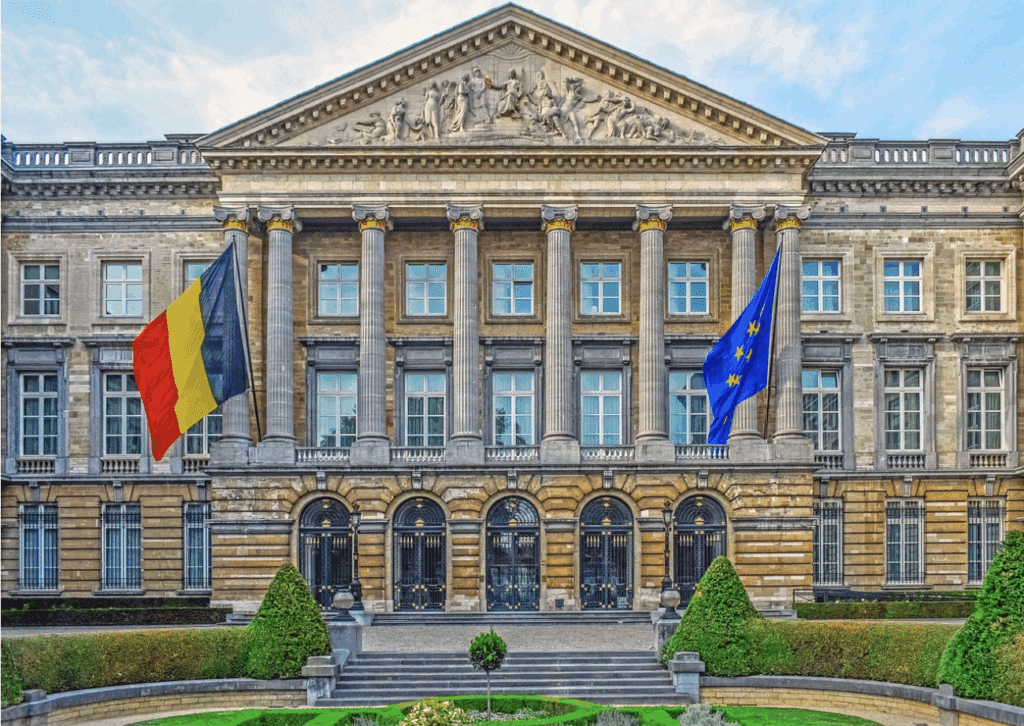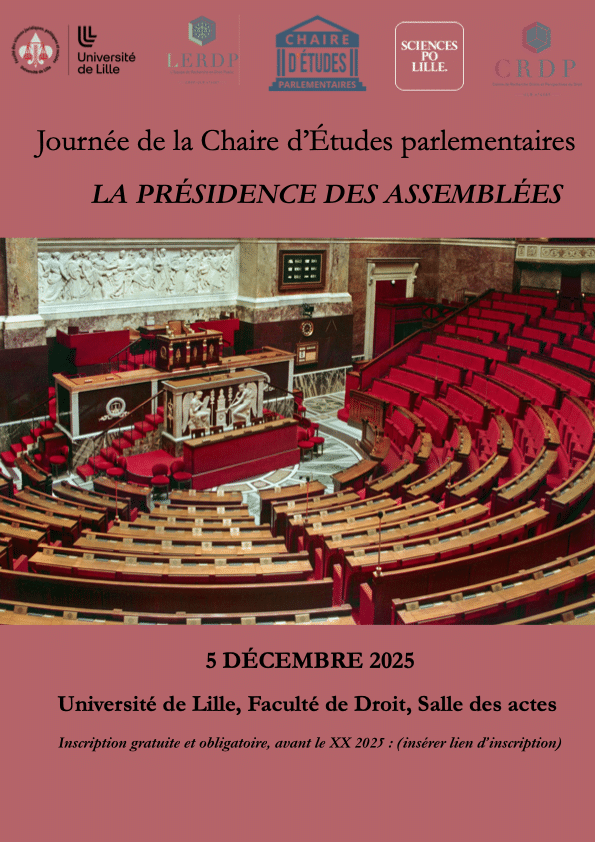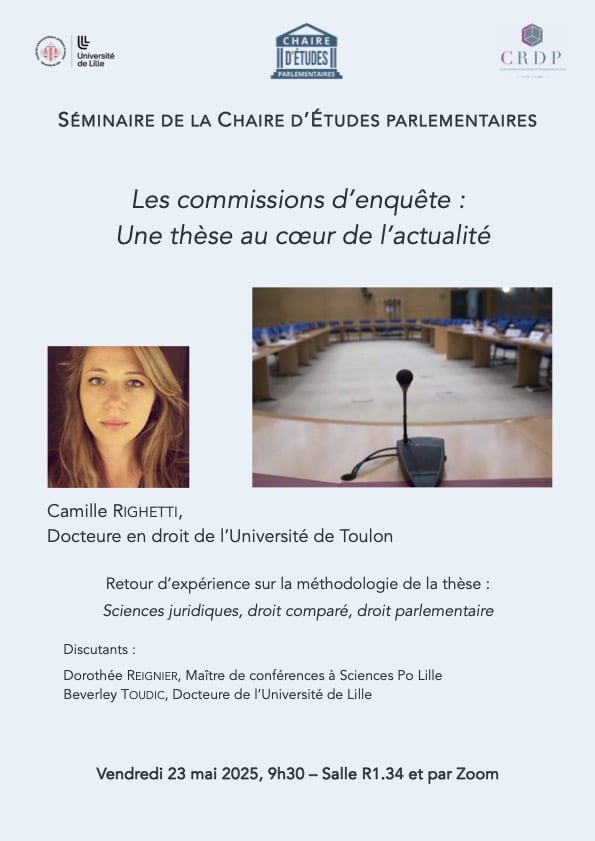Depuis près de 500 jours, la Région de Bruxelles-Capitale demeure sans gouvernement de plein exercice. Cette composante de la Fédération belge, fonctionnant comme un régime parlementaire, peine à dégager la majorité – plus précisément la double majorité (1) – nécessaire à la formation d’un exécutif. Cette Région, qui coïncide avec la capitale de la Belgique, constitue également le lieu de rencontre des deux grandes communautés linguistiques du pays : les francophones et les néerlandophones (ou flamands). Les tensions communautaires autour de Bruxelles ont conduit à l’adoption d’un système politique doté de nombreuses garanties en faveur des néerlandophones, minoritaires dans la capitale (2).
Le Parlement bruxellois compte ainsi 72 députés francophones et 17 députés néerlandophones. Le Gouvernement, composé de ministres issus des deux groupes linguistiques, doit être élu par une majorité au sein de chacun d’eux. Pour diverses raisons politiques sur lesquelles nous ne nous attarderons pas, la formation du gouvernement, qui s’effectuait habituellement en moins d’un mois, se trouve cette fois paralysée. La configuration issue des élections de juin 2024, conjuguée à un contexte budgétaire particulièrement critique, a conduit à une crise politique sans précédent au sein d’une entité fédérée. Aucun accord n’a pu encore être trouvé entre une majorité de partis francophones et une majorité de partis néerlandophones pour constituer un gouvernement.
I) Quand le parlementarisme rationalisé devient élément de blocage
Dans un régime parlementaire classique, une piste envisageable dans une telle situation de blocage peut être la dissolution du Parlement. Certains estiment même que la possibilité d’une telle dissolution anticipée est même constitutive du parlementarisme (3). Cependant, à Bruxelles, comme dans les autres entités fédérées, il n’existe actuellement pas de mécanisme de dissolution. L’explication historique vient de ce qu’à l’origine les assemblées des entités fédérées étaient composées de députés du Parlement fédéral (4). Dans ce contexte, donner un droit de dissolution aux entités fédérées aurait eu des répercussions sur l’assemblée fédérale.
A cette impossibilité de la dissolution, s’ajoutent certaines règles du parlementarisme rationalisé propres aux entités fédérées belges qui compliquent la formation du gouvernement.
D’abord, le gouvernement doit être élu par une majorité de députés francophones et néerlandophones apportant directement et positivement leur soutien. Autrement dit, il n’est pas possible pour des partis qui seraient extérieurs au gouvernement de se limiter à ne pas s’opposer à la mise en place d’un gouvernement minoritaire par des abstentions.
Ensuite, le droit constitutionnel belge prévoit que le gouvernement est élu par le Parlement au niveau des entités fédérées. Ceci signifie qu’il n’existe pas d’autorité externe – comme le Roi au niveau fédéral – pour nommer les ministres et jouer potentiellement un rôle d’arbitre et de maître des horloges dans la formation du gouvernement. Il n’est donc pas possible de forcer le Parlement à s’exprimer sur une proposition de gouvernement.
Par ailleurs, la motion de confiance, qui permet au gouvernement de resserrer les rangs de la majorité et qui est envisagée comme un moyen de pression de l’exécutif sur le Parlement, est encadrée juridiquement d’une telle manière qu’elle ne peut remplir cette fonction. En effet cette motion nécessite le soutien d’une majorité de députés et non une majorité relative, par exemple des suffrages exprimés. Ici encore, une abstention ne suffit pas. Le rejet d’une motion de confiance posée par le gouvernement rend celui-ci automatiquement démissionnaire. Par ailleurs, à Bruxelles, contrairement à l’élection du gouvernement régional, la motion de confiance ne requiert pas de double majorité linguistique. Ceci implique qu’un gouvernement qui perdrait sa majorité dans un groupe linguistique pendant la législature, mais conserverait une majorité globale sur le Parlement, pourrait rester de plein exercice.
En outre, les conditions de la mise en œuvre de la « motion de méfiance» sont telles qu’elle ne constitue pas forcément un outil à la disposition de l’opposition. Comme on l’a vu récemment en France avec le gouvernement Barnier, ce mécanisme permet au Parlement de renverser l’exécutif. Mais, à Bruxelles, un « motion de méfiance » doit être adoptée non seulement par une majorité du Parlement, mais aussi par une majorité de chaque groupe linguistique. Elle doit, en outre, être constructive : elle n’est recevable que si elle présente un successeur au gouvernement. La majorité qui censure l’exécutif doit donc proposer une alternative, ce qui rend l’outil beaucoup plus difficile à utiliser. La conséquence est que des partis souhaitant soutenir de l’extérieur l’installation d’un gouvernement minoritaire pourraient se retrouver dans l’impossibilité de faire tomber ce gouvernement, et donc d’exercer un moyen de pression sur celui-ci.
Tous ces éléments ferment donc la porte à certaines solutions, comme celle du gouvernement minoritaire, qui auraient pu permettre de dégager un exécutif de plein exercice. Cette situation découle de l’histoire des entités fédérées : lors de leur création, il n’était pas acquis qu’elles s’inscriraient pleinement dans le régime parlementaire, comme au niveau fédéral. On a ainsi importé certains mécanismes venus du droit des autorités locales, tels que l’élection du gouvernement.
II) Les obstacles à l'instauration d'un mécanisme de dissolution
Les articles 117 et 118 de la Constitution organisent la durée et les modalités des élections des Parlements de communauté et de région. L’article 117 fixe une règle de principe : ces Parlements sont élus pour cinq ans et renouvelés intégralement tous les cinq ans, à la même date que les élections européennes. Il ne peut être dérogé à ce calendrier qu’au moyen d’une loi spéciale (6), adoptée conformément à l’article 118, qui confère aux entités fédérées la compétence de déterminer elles-mêmes la durée de leur législature et la date de leurs élections. Une disposition transitoire impose toutefois que cette compétence ne puisse entrer en vigueur qu’en même temps que l’activation des articles 46 et 65 de la Constitution, qui feraient coïncider les élections fédérales avec les européennes. Or, aucun accord politique n’existe à ce jour pour activer ces articles, ce qui empêche, en pratique, la mise en œuvre de cette faculté.
Sur cette base, quatre constats peuvent être dégagés.
Primo, la Constitution impose actuellement un renouvellement quinquennal et simultané des Parlements de communauté et de région lors des élections européennes.
Secundo, seule une loi spéciale peut permettre d’y déroger, en attribuant aux entités fédérées la compétence de fixer elles-mêmes la durée de leur législature et la date de leurs élections. Toutefois, il n’est pas clairement établi si le législateur spécial peut accorder cette compétence à une seule entité, comme la Région de Bruxelles-Capitale, sans l’étendre également par la même occasion aux autres entités. Les travaux préparatoires ne permettent pas de trancher cette question, et la formulation des articles ouvre la voie à plusieurs interprétations.
Tertio, la disposition transitoire de l’article 118 rend toute attribution effective de cette compétence dépendante de la mise en œuvre parallèle des articles 46 et 65 de la Constitution, une étape qui apparaît bloquée au plan politique.
Quarto, si la Région bruxelloise recevait la compétence de changer la date de ses élections, elle devrait l’exercer par une ordonnance spéciale, adoptée à la majorité des deux tiers et avec majorité dans chaque groupe linguistique.
Au-delà de ces questions procédurales, l’instauration d’un mécanisme de dissolution à Bruxelles fait face à des obstacles institutionnels. En effet, des élections anticipées à Bruxelles auraient des effets en cascade sur les autres assemblées. Pour le Parlement de la Communauté française, dont 19 des 94 membres sont issus du groupe francophone du Parlement bruxellois, un changement du rapport de forces à Bruxelles pourrait renverser la majorité communautaire actuelle, qui ne tient qu’à trois sièges bruxellois. Pour le Parlement flamand, les six membres bruxellois sont élus directement parmi les électeurs néerlandophones du Parlement bruxellois. Si les élections bruxelloises et flamandes ne se tenaient pas le même jour, il serait impossible d’identifier le corps électoral bruxellois flamand. En effet, les électeurs habilités à voter pour les membres bruxellois du Parlement flamand sont déterminés sur la base de ceux ayant voté dans le collège linguistique néerlandophone lors des élections du Parlement bruxellois. Si ces élections ont lieu à des dates différentes, il deviendrait impossible d’identifier les électeurs habilités à élire les 6 membres bruxellois du Parlement flamand. Dès lors, les élections flamandes et bruxelloises doivent nécessairement être simultanées. La seule manière d’y déroger serait que le Parlement flamand réforme lui-même son mode d’élection des membres bruxellois, ce qui impliquerait une coordination complexe entre entités fédérées. Certains auteurs ajoutent que toute élection partielle d’un Parlement de communauté serait contraire à l’article 117, qui impose un renouvellement intégral, interdisant de facto un décalage électoral (7).
En conclusion, tant les limites constitutionnelles que les contraintes institutionnelles et politiques rendent aujourd’hui impossible toute dissolution du Parlement bruxellois. Une telle évolution ne pourrait voir le jour qu’à travers une réforme de l’Etat, c’est-à-dire dans le cadre d’un processus long et politiquement délicat.
(1) Le Gouvernement, composé de ministres issus des deux groupes linguistiques représentés au Parlement, doit être élu par une majorité au sein de chacun d’eux.
(2) Il n’y a pas de recension officielle, mais on estime que moins de 10% de la population bruxelloise a le néerlandais comme langue maternelle. Toutefois, plus de 250.000 Flamands viennent travailler tous les jours à Bruxelles.
(3) Voy. A.W. BRADLEY et C. PINELLI, « Parliamentarism », in M. Rosenfeld et A. Sajò (ed.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 664 et 665.
(4) P. LAUVAUX, Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir exécutif. Quelques aspects de la réforme de l’Etat confrontés aux expériences étrangères, Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 202.
(5) Terme belge équivalent à une motion de censure.
(6) Une loi spéciale se situe dans la hiérarchie des normes entre une loi ordinaire et la Constitution. Son adoption requiert une majorité spéciale à savoir 2/3 des suffrages exprimés à la Chambre des représentants et au Sénat et une majorité dans chaque groupe linguistique.
(7) M. EL BERHOUMI, C. ROMAINVILLE, « Le parlementarisme rationalisé des entités fédérées : vecteur d’instabilité », Revue Belge de Droit Constitutionnel (n° spécial Les enjeux constitutionnels de la crise politique francophone de l’été 2017, 2018, pp. 29-30.