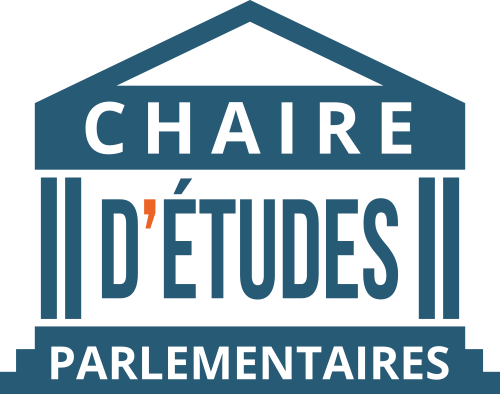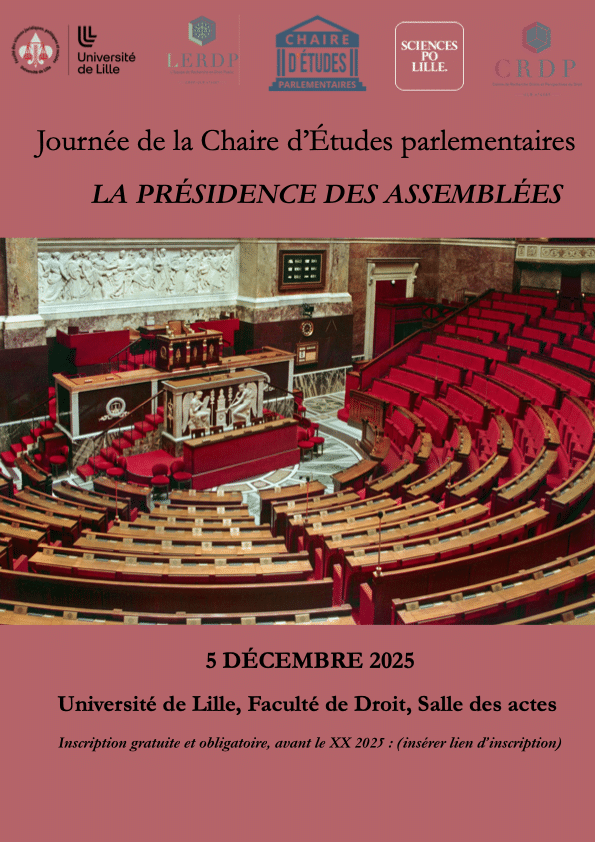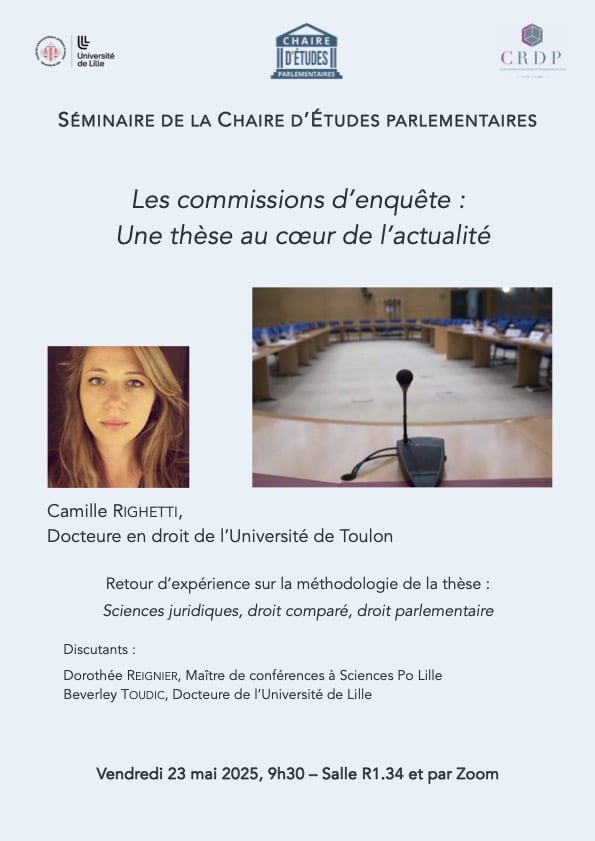Au cours d’une conférence facultaire, organisée par la Chaire d’Études parlementaires le 4 novembre 2025, le Professeur Jean-Philippe Derosier a accueilli Télésphore Ondo, Professeur de droit public à l’Université Omar Bongo de Libreville (Gabon) et ancien membre du comité constitutionnel national. Aujourd’hui conseiller spécial du Président de la République du Gabon, il a mis en lumière les différentes étapes du processus transitionnel constituant qu’a connu le Gabon.
Le 30 août 2023, alors que les résultats de l’élection proclament, pour un troisième mandat consécutif, Ali Bongo Ondimba Président de la République gabonaise, des militaires prennent le pouvoir de manière quasiment immédiate. Par ce coup d’État, ladite élection est annulée tandis que les institutions précédentes et la Constitution du 26 mars 1991 sont abrogées. Les militaires dénonçaient à ce titre le système autoritaire actuellement au pouvoir et agissaient dans l’espoir que le Gabon se transforme en véritable démocratie, fondée sur l’État de droit et le respect des droits fondamentaux des citoyens.
Ces militaires se sont regroupés pour former le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), puis ont instauré une Charte pour la transition, laquelle leur donnait mission d’élaborer une nouvelle Constitution par le biais de mécanismes participatifs, pluralistes et démocratiques.
Dans cette perspective, le CTRI s’est attelé à mettre en place les modalités de participation directe des populations à l’élaboration et à l’adoption de cette Constitution, ce qui marque ainsi une rupture totale avec les processus antérieurs. En effet, les Constitutions précédentes (1) représentaient davantage un système autoritaire et l’empreinte de l’ancienne puissance coloniale plutôt que la volonté de consolider un véritable système démocratique. C’est d’ailleurs la première fois qu’une Constitution est élaborée par des gabonais eux-mêmes.
Ainsi, le Gouvernement a appelé l’ensemble des citoyens gabonais à contribuer à la rédaction de la nouvelle Constitution par le biais d’un « dialogue national inclusif ». Les 38 140 contributions recueillies (entre octobre à décembre 2023) ont fait l’objet de conclusions regroupées par le comité constitutionnel national et ont permis de fixer les grands principes (2) de la nouvelle Constitution gabonaise, notamment concernant la souveraineté du peuple, le régime politique, l’agencement des pouvoirs ou encore les nouveaux droits fondamentaux et leur garantie.
À l’issue de la rédaction de ce projet de loi constitutionnelle, les deux assemblées de la transition ont été invités à exprimer leur avis quant au projet rédigé par le CTRI. S’agissant de parlementaires nommés par le Président de la transition, leur mode de désignation interroge quant au caractère démocratique de ces assemblées. Néanmoins, on a pu constater qu’elles bénéficiaient de la meilleure représentativité que le Parlement du Gabon ait pu connaître dans toute son histoire. En effet, l’origine pluraliste des députés et sénateurs (partis politiques variés, société civile, société militaire, milieux religieux, syndicats, populations rurales et autochtones, etc.) a conféré au Parlement une représentation réelle et effective de la population, dans toute sa diversité, de façon inédite. À ce titre, les parlementaires ont participé activement et ont proposé pas moins de 801 amendements.
Après que le projet final a été rédigé par l’Exécutif, il a été soumis au référendum le 16 novembre 2024 à la suite d’une campagne de sensibilisation de la population sur les enjeux de la nouvelle Constitution. Celle-ci a été approuvée à 91,64% avec un taux de participation de 54,18%.
Le processus transitionnel constituant gabonais se distingue également par la double garantie dont il a fait l’objet. En effet, afin d’éviter un éventuel despotisme du pouvoir constitutionnel, le CTRI a jugé nécessaire d’instaurer des mécanismes de protection à la fois politique et juridictionnelle.
Sur le plan politique, deux organes étaient chargés d’assurer la légitimité du processus constitutionnel en cours. Le premier, le Comité de Surveillance de la mise en œuvre des Conclusions du Dialogue National Inclusif, devait veiller à ce que les conclusions du dialogue national inclusif soient effectivement respectées par le Gouvernement dans l’élaboration du projet de loi constitutionnelle. Le second, le Comité de Suivi et d’Évaluation de la mise en œuvre des Conclusions du Dialogue National Inclusif, devait, quant à lui, s’assurer que des mécanismes de suivi et de contrôle de l’élaboration de la Constitution soient mis en place afin de garantir la cohérence de celle-ci avec la volonté souveraine du peuple constituant.
Enfin, sur le plan juridictionnel, la Cour constitutionnelle de la transition a également assuré la garantie de l’ensemble du processus. À cet égard, elle a affirmé la valeur supra-constitutionnelle de la Charte de la transition, ce qui a eu pour conséquence de légitimer le référendum initié par le Président de la transition pour l’adoption de la nouvelle Constitution. En ce sens, la Cour constitutionnelle de transition a consolidé la légalité du processus transitionnel constituant.
Ces différentes étapes ont donné naissance à la nouvelle Constitution gabonaise, promulguée le 19 décembre 2024. Celle-ci a ouvert la voie à une série d’échéances électorales et institutionnelles prévues par le chronogramme fixé dès le début de ce processus transitionnel constituant. Ont ainsi eu lieu les élections locales et législatives les 27 septembre et 11 octobre ainsi que l’installation de l’Assemblée nationale le 4 novembre. Restent à venir les élections sénatoriales les 8 et 29 novembre, la mise en place du Conseil économique et social le 1er décembre puis l’installation du Sénat le 15 décembre. Enfin, la nomination des juges constitutionnels le 23 décembre viendra clore ce processus.
(1) Constitution du 19 février 1959 adoptée dans le cadre de la Communauté française instituée par la Constitution de 1958 ; Constitution du 14 novembre 1960 instituant un régime parlementaire ; Constitution du 21 février 1961 modifiée à plusieurs reprises et qui consacre le régime présidentialiste autoritaire ; Constitution du 26 mars 1991 restaurant formellement la démocratie pluraliste.
(2) L’article 2 du décret n°0191/PT-PR/MRI affirme que le Comité constitutionnel national doit procéder à la rédaction du projet de Constitution sur la base exclusive du rapport du dialogue national inclusif néanmoins en réalité ces conclusions ont permis de fixer les grands principes de la Constitution.