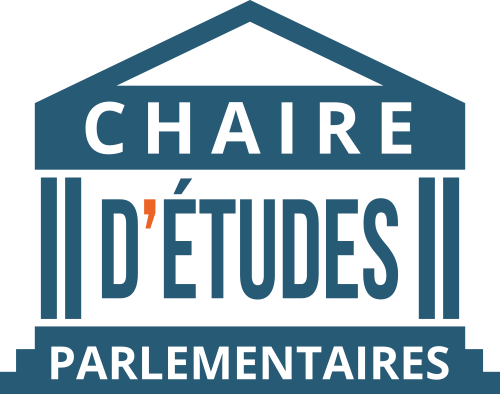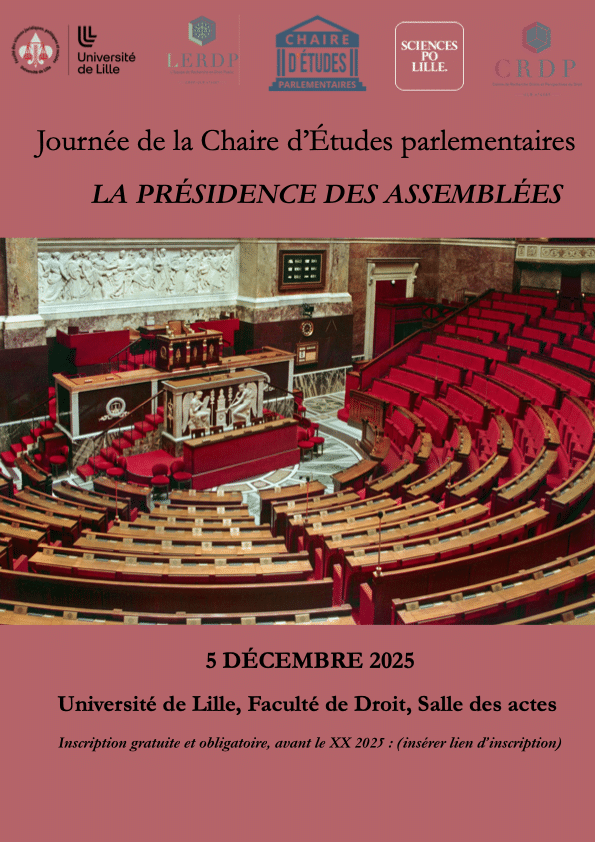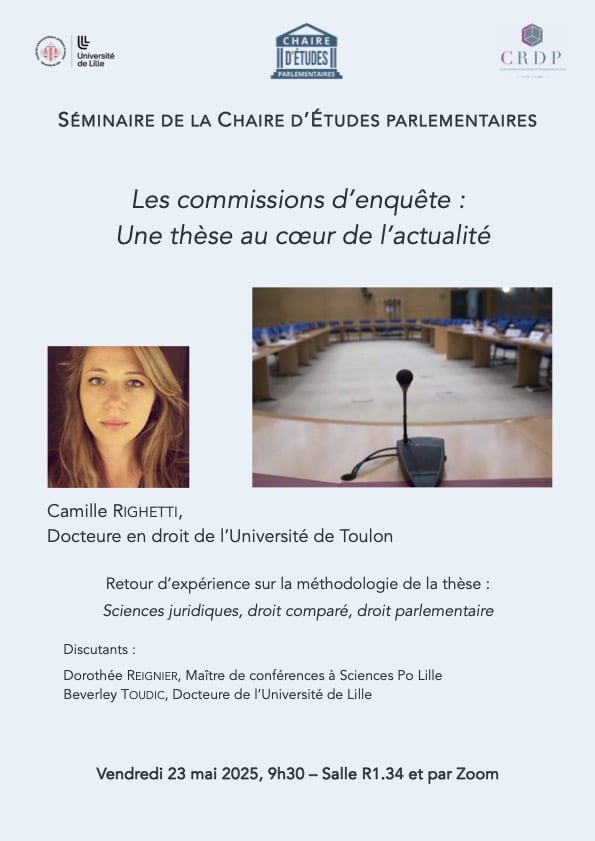Lors d’une conférence de presse du 25 août, François Bayrou avait annoncé engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale, le 8 septembre, autour de la question de la maîtrise des finances publiques. Il devait s’agir selon lui d’un moment de clarification. Compte tenu de la configuration politique de l’Assemblée nationale, cette décision paraissait mettre sérieusement en péril la pérennité du Gouvernement soutenu par une coalition composée de 210 députés – la majorité absolue étant fixée à 288. Outre l’appui de ces 210 députés, il s’agissait donc d’obtenir l’approbation de soixante-dix-huit des 364 autres députés de l’opposition ou bien l’abstention de 155 d’entre eux (la confiance requérant la majorité des suffrages exprimés et non la majorité des membres de l’Assemblée nationale). Les déclarations des différents représentants des formations politiques d’opposition entre le 25 août et le 8 septembre ne laissaient présager aucune issue favorable pour François Bayrou. Le maintien de ce dernier semblait alors relever du miracle. Le miracle n’eût toutefois pas lieu comme le manifeste le résultat du vote du 8 septembre. En effet, 364 députés ont voté contre la déclaration de politique générale de François Bayrou, obligeant ce dernier, conformément à l’article 50 de la Constitution, à présenter sa démission au Président de la République, une première sous la Ve République.
Voilà plus de cinq ans qu’un Premier ministre n’avait eu recours à la procédure prévue à l’article 49, alinéa 1, de la Constitution qui permet au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité de son Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
Il convient de rappeler que le fait de recourir à cette disposition relève de considérations purement politiques. En effet, juridiquement, le Premier ministre n’est jamais tenu de solliciter la confiance de l’Assemblée nationale. Il s’agit de « l’arme du Gouvernement et de lui seul », selon les mots mêmes de Michel Debré, devant le Conseil d’Etat (le 27 août 1958). Relevant donc exclusivement d’une logique d’opportunité politique, cette procédure a donné lieu, dans la pratique, à des usages diversifiés. Certains Premiers ministres n’y ont pas recouru, soit en raison de l’absence de majorité absolue, comme Edith Cresson (en 1991), Elisabeth Borne (en 2022), Gabriel Attal (en 2024), ou tout simplement car ils n’ont pas estimé cela nécessaire, comme Pierre Messmer (en 1972) – le Premier ministre tenant sa légitimité du Président de la République. D’autres se sont saisis de cette disposition seulement à la suite de leur nomination ou de leur reconduction afin d’annoncer les grandes lignes de la politique gouvernementale (1). Outre ce moment solennel, certains Premiers ministres y ont eu recours plus tard dans l’exercice de leurs fonctions (2). Dans l’ensemble des cas, le but recherché consistait à offrir une légitimité parlementaire au Gouvernement fraîchement nommé ou remanié, de redonner du souffle à la politique gouvernementale, de discipliner une majorité divisée, ou encore de mettre en avant un sujet, une politique précise. Quelles qu’aient été les motivations politiques, le résultat du vote était acquis d’avance dans les quarante et un précédents recours à cette disposition. Dans le cas de François Bayrou, pour la première fois, l’issue attendue, d’abord incertaine, s’est rapidement révélée défavorable.
Plus encore que le rejet lui-même, c’est son caractère prévisible qui est inédit. Précisément, le fait qu’un Premier ministre sollicite la confiance de l’Assemblée à un autre moment que celui de sa nomination, sur un sujet précis, alors même qu’il détient une majorité précaire n’est pas nouveau. En 1991, Michel Rocard avait en effet usé de cette procédure afin d’obtenir l’adhésion des députés au sujet de l’engagement de la France dans la Guerre du Golfe. Pierre Bérégovoy, quant à lui, en avait usé en 1992 dans le cadre des négociations sur l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). L’un comme l’autre était dépourvu de majorité absolue au Palais Bourbon. Toutefois, les deux sujets évoqués étaient relativement consensuels dans la classe politique et les deux Premiers ministres concernés avaient pris le soin de préciser que ceux qui voteront en faveur de la déclaration de politique générale ne seront en aucun cas présumés soutenir la politique générale du Gouvernement. Michel Rocard et Pierre Bérégovoy n’avaient donc pas à douter de l’issue des scrutins qui ont confirmé l’adhésion majoritaire de l’Assemblée nationale, malgré l’existence d’une coalition gouvernementale minoritaire. A l’inverse, l’extrême difficulté pour François Bayrou d’obtenir un vote favorable pouvait être anticipée, eu égard au caractère peu consensuel de la politique menée depuis sa prise de fonction.
François Bayrou avait toutefois cherché à donner un caractère consensuel à sa déclaration de politique générale. Selon lui, il s’agissait de s’accorder sur le constat – « le diagnostic » – avant même d’évoquer les mesures. Le Premier ministre avait en effet usé d’une métaphore médicale en estimant qu’il serait absurde d’établir « l’ordonnance avant de faire le diagnostic ». En réalité, il s’agissait un peu plus que cela car le Premier ministre a estimé que la question, au-delà du constat, était de savoir si « on allait augmenter ou freiner les dépenses ». Dans ce sens, au-delà d’une adhésion sur le constat, il s’agissait de rechercher une adhésion quant à la stratégie à adopter qui, selon le Premier ministre, devait davantage s’axer sur une baisse des dépenses que sur une augmentation des recettes. Dès lors, le consensus semblait difficile à atteindre, d’autant plus que le Premier ministre avait déjà annoncé les mesures envisagées pour remédier aux difficultés financières du pays. Le débat a alors davantage porté sur les dispositions que comporterait le futur budget que sur le constat de l’état des finances publiques. De fait, le consensus paraissait impossible, donc la chute inéluctable.
Puisqu’il s’agissait davantage de lancer un débat sur les mesures à adopter pour redresser les comptes publics que de simplement alerter la représentation nationale sur l’état des finances, il eut sans doute été préférable de ne pas recourir à l’article 49, alinéa 1, et de se saisir de la discussion budgétaire pour trancher ces questions, quitte à recourir à l’article 49, alinéa 3, à l’instar de Michel Barnier. François Bayrou préféra toutefois renouer avec la vieille tradition romaine du « suicide politique ». Or, utiliser l’article 49, alinéa 1, à des fins sacrificielles ne paraît guère conforme à l’esprit institutionnel de la Ve République. Par cette pratique, le Premier ministre a dénaturé une procédure qui n’a jamais été conçue comme une porte de sortie de l’Hôtel de Matignon.
Ce ne sont donc pas les mécanismes du parlementarisme rationnalisé de la Ve République — précisément conçus pour faire face à des majorités incertaines — qu’il convient de mettre en cause, mais bien plutôt le mésusage qu’en font certains acteurs politiques lorsqu’ils les détournent de leur finalité : la mise en œuvre de la politique de la Nation.
(1) C’est le cas de Georges Pompidou (en avril et octobre 1962), de Pierre Messmer (en 1973), de Jacques Chirac (en 1974), de Raymond Barre (en 1978), de Laurent Fabius (en 1984), de Lionel Jospin (en 1997), de Jean-Pierre Raffarin (en 2002 et 2004), de Dominique de Villepin (en 2005), François Fillon (en 2010), de Jean-Marc Ayrault (en 2012), de Manuel Valls (en avril et septembre 2014), de Bernard Cazeneuve (en 2016) et de Jean Castex (en 2020).
(2) C’est le cas de Michel Debré (en janvier et octobre 1959), de Jacques Chaban-Delmas (en 1969, 1970 et 1972), de Pierre Mauroy (en juillet 1981, octobre 1981, 1982, 1983 et 1984), de Jacques Chirac (en 1986, avril et décembre 1987), d’Edouard Balladur (en avril et décembre 1993), d’Alain Juppé (en mai et novembre 1995, et 1996), de François Fillon (en 2007 et 2009) et d’Edouard Philippe (en 2017 et 2019). C’est également le cas de Raymond Barre (en 1977), Michel Rocard (en 1991) et Pierre Bérégovoy (en 1992) qui ont usé de cette procédure alors même qu’ils ne l’avaient pas fait à la suite de leur nomination.