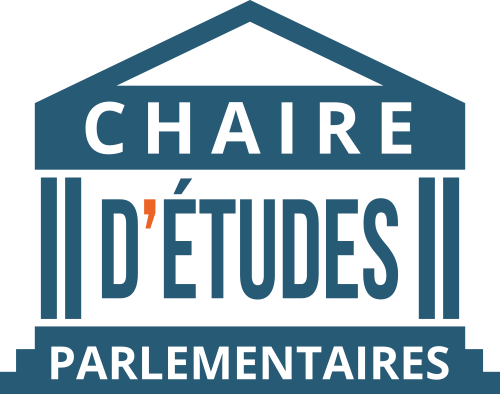De quel scrutin proportionnel parle-t-on lorsqu’on parle de « la proportionnelle » ? Y a-t-il des modalités préférables à d’autres ?
Bruno Daugeron : D’une certaine manière, l’expression « la proportionnelle » ne veut rien dire tant ce mode de scrutin renvoie à des traductions diverses et diversement concrétisées. Une fois acceptée l’idée simple à l’origine de la revendication proportionnaliste née à la fin du XIXe siècle selon laquelle une assemblée parlementaire doit être composée des tendances politiques exprimées dans l’élection en faisant en sorte qu’à un certain pourcentage de voix correspondent le pourcentage le plus proche possible de sièges, de multiples modalités sont possibles. Les paramètres des modalités sont eux-mêmes nombreux : le nombre de sièges répartis selon ce mode de scrutin qui peut aller du tout à seulement une partie par combinaison avec un autre, la circonscription au sein de laquelle va se dérouler l’élection pour une assemblée nationale (nation, région, département pour la France) qui va faire jouer différemment la répartition proportionnelle des sièges, l’existence ou non d’une seuil à partir duquel l’attribution des voix permettra une répartition des sièges, celle d’une éventuelle prime majoritaire qui relativise l’effet proportionnalisant du scrutin ou encore le nombre de tours… Les phases postérieures au calcul du quotient électoral (division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges) déterminant la répartition des sièges pouvant elles-mêmes varier en fonction de la méthode de répartition des voix non comptabilisées : soit le plus fort reste, soit la plus forte moyenne soit la méthode dite d’Hondt et ce faisant atteindre un degré de sophistication qui explique à la fois la réputation de complexité de la « RP » (représentation proportionnelle) et le fait qu’elle ne peut jamais être réellement intégrale.
Il est donc difficile d’identifier des modalités « préférables à d’autres » indépendamment des fins qu’une loi instaurant la proportionnelle se serait assignée. Si la finalité est la plus grande adéquation possible entre les voix et les sièges dans une logique de proportionnelle intégrale, c’est-à-dire valant pour l’intégralité des sièges et sans seuil, alors la proportionnelle au niveau national s’impose puisque c’est elle qui permet la plus grande égalité de destination des voix. Si, au contraire, on souhaite seulement « proportionnaliser » partiellement un scrutin majoritaire pour ne pas lui ôter ses effets, alors il faudra identifier la circonscription au sein de laquelle cette finalité peut être atteinte et la « dose » de RP. Mais il est vrai que pour pouvoir réellement parler de proportionnelle, il faut encore que l’idée fondatrice évoquée plus haut y soit traduite avec un minimum d’ampleur. Et de ce point de vue, un scrutin ne peut avoir des effets proportionnels que si suffisamment de sièges trouvent à s’y distribuer, sachant que depuis le redécoupage de circonscriptions de 2008, de nombreux départements ne comprennent plus que deux députés (voire un seul comme en Lozère) réduisant les effets proportionnalisants (au Sénat la proportionnelle ne jouant qu’à partir de trois sièges dans la cadre départemental).
Jean-Philippe Derosier : Il est nécessaire de distinguer, en effet, entre « la » proportionnelle et « une » proportionnelle, c’est-à-dire entre le principe de la représentation proportionnelle et une modalité de mise en œuvre de ce principe. Le principe correspond au souhait qu’une assemblée soit élue conformément – « proportionnellement » – au poids des différentes forces politiques qui prétendent y siéger. Une fois que ce principe est posé, des modalités de mise en œuvre doivent être arrêtées pour déterminer comment est exactement calculé le nombre de sièges auquel chacune de ces forces politiques (qui ont présenté des listes de candidats) peut prétendre. Ces modalités sont nombreuses et concernent non seulement le nombre de sièges à pourvoir et la circonscription de référence, mais aussi le nombre de tours, les seuils ou encore l’existence de « primes ».
Si on prend l’exemple de l’Assemblée nationale française, il y a 577 sièges à pourvoir. De la circonscription de référence dépendra le nombre de sièges affectés à chacune d’entre elles : s’il n’y en a qu’une seule, nationale, alors elle comportera 577 sièges mais si on retient comme référence la circonscription régionale ou départementale, alors le nombre sera moindre et différent d’une circonscription à l’autre, en raison des écarts de population. Plus la circonscription sera grande, plus le nombre de sièges à pourvoir sera élevé, donc plus la possibilité d’accéder à la répartition des sièges sera aisée. En effet, si la circonscription de référence est le département et qu’il n’y a que cinq sièges à pourvoir dans certains d’entre eux, un parti qui obtiendrait 10% des voix, aurait droit à 10% des sièges, soit un demi-siège… À l’inverse, si la circonscription est nationale, un parti qui obtiendrait 10% des voix, aurait droit à 57,7 sièges ! En d’autres termes, une grande circonscription favorise les petits partis et encourage le multipartisme.
À cela s’ajoutent les modalités relatives au nombre de tours, aux seuils et à l’existence d’une éventuelle prime. Aujourd’hui, la France ne connaît que des élections proportionnelles à deux tours (municipales et régionales, on met les européennes à part, qui ne relèvent pas de la République), mais les seules élections législatives qui ont été organisées à la proportionnelle sous la Ve République (en 1986) n’avaient qu’un seul tour. Si deux tours sont prévus, il faut prévoir une règle de qualification au second tour (généralement un seuil à atteindre au premier tour, faute d’obtenir la majorité absolue) et, éventuellement, une possibilité, pour des listes éliminées, de fusionner avec des listes qualifiées. Aux élections municipales et régionales, seules les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter au second, tandis que les listes ayant obtenu 5% de ces suffrages peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu 10%. Mais on peut imaginer que ce seuil soit plus bas… ou plus élevé ! De plus, un seuil peut également être exigé pour concourir à la répartition des sièges, afin de limiter le morcellement politique et éliminer les listes qui n’obtiendraient qu’un faible nombre de suffrages. Ce seuil est de 5% aux élections municipales et régionales (et de 3% aux élections européennes), mais on peut l’élever ou l’abaisser. Plus il sera élevé, moins les petits partis auront de chances d’obtenir des sièges et plus le morcellement sera évité – et réciproquement.
Enfin, une prime peut être imaginée pour la liste arrivée en tête, comme c’est le cas aux élections municipales et régionales : respectivement la moitié et un quart des sièges sont attribués à la liste arrivée en tête. Ce levier permet de garantir ou de renforcer la probabilité qu’une liste (donc, a minima, une coalition) dispose d’une majorité, mais fausse la « proportion ».
Le cumul et le mélange de ces modalités permet d’imaginer de nombreuses variantes de « la » proportionnelle : d’un scrutin assis sur une circonscription nationale, à un seul tour, avec un seuil de représentation à 1% à un scrutin assis sur une circonscription départementale, à deux tours, avec un seuil de qualification à 10% (ou plus) et un seuil de représentation à 5% (ou plus), ainsi qu’une prime majoritaire, on voit que les effets seraient nettement différents.
Plus les modalités sont exigeantes (circonscription étroite, nombre de tours élevés, seuils élevés), moins les effets d’une proportionnalité seront visibles.
Le scrutin proportionnel renforce-t-il la représentativité du peuple et de la Nation à l’Assemblée nationale ?
Bruno Daugeron : D’une certaine manière, la question est dépourvue de sens même si on comprend pourquoi elle finit par être posée. Dépourvue de sens d’abord et surtout car, si par « représentativité » on entend ressemblance entre le peuple et la nation et « leur » assemblée, le scrutin proportionnel n’est d’aucune utilité. Pourquoi ? Car du point de vue juridique, ni le peuple ni la nation ne sont des entités réelles et préexistantes à leur volonté dont l’existence serait conditionnée par une quelconque ressemblance comme s’il y avait des degrés dans l’expression de cette volonté. Que l’un ou l’autre soit proclamé souverain, leur volonté sera toujours identique à elle-même et donc toujours ce qu’elle est censée être puisque l’un et l’autre n’existent qu’au travers et par la volonté qui leur sera imputée. Car « représentative », pour une assemblée, ne veut pas originellement dire ressembler à une quelconque entité préexistent – peuple, nation voire corps électoral à « l’opinion » ou à la société dans ses dimensions politique ou sociologique comme une photographie peut ressembler à un paysage – mais que l’Assemblée nationale, comme composante du Parlement, est habilitée par la Constitution à vouloir pour le peuple souverain, c’est-à-dire à exprimer sa volonté. Comment ? A travers le vote de la loi, expression de la volonté générale. On dit depuis la Révolution que les représentants « veulent pour la nation » ou pour le peuple selon le nom que l’on donne au souverain. C’est ainsi qu’ils le représentent. Sur quel fondement ? Juridiquement, sur l’article 3 de notre Constitution qui dispose que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voix du référendum ». L’acte de représentation se fait donc par le vote de la loi qui actualise en permanence la souveraineté du peuple qui ne saurait être exercée en une seule fois pour toute la législature par la seule élection des députés par les électeurs. L’élection est seulement le moyen mis à disposition du corps électoral pour désigner ceux qui vont être habilités à vouloir pour le souverain, c’est-à-dire à former sa volonté par la loi. De ce point de vue donc, aucun mode de scrutin ne changera cette réalité constitutionnelle.
Mais cette fiction juridique indispensable est en même temps piégée. Le sens donné à « représentatif » a en effet changé avec le temps par la signification donnée à l’élection et son poids dans le processus, représentation et représentativité ayant progressivement été dissociés. De « vouloir pour la nation », le sens de représentation est passé à délégué par elle par l’élection voire ressemblant à elle. Et dès lors que l’on considère qu’un bon représentant doit non seulement être élu mais ressembler à ceux qui l’élisent pour faire la volonté du peuple avec lequel les électeurs sont confondus, difficile de ne pas exiger la première des ressemblances : la concordance politique entre élus et électeurs à proportion de leurs choix que seule permet la « RP ».
Jean-Philippe Derosier : De façon générale, il est avancé que le scrutin proportionnel permet de mieux refléter la diversité des opinions de la Nation, donc d’en assurer une représentation plus fidèle. Ce « lieu commun » doit toutefois être doublement tempéré. D’une part, dans le prolongement des éléments de réponse à la question précédente, la réponse dépend des modalités de mise en œuvre du scrutin proportionnel. Sans aller dans les extrêmes, un scrutin proportionnel à un seul tour sur la base d’une circonscription régionale, avec un seuil de représentation à 5%, pourrait quasiment éliminer des petits partis qui décideraient de se lancer sans coalition aucune (comme le parti communiste, par exemple, si on devait faire une extrapolation des résultats qu’il a obtenu aux élections européennes, toutes choses égales par ailleurs). D’autre part, on voit que, depuis 2017, le nombre de groupes parlementaires à l’Assemblée nationale ne cesse d’augmenter, car la bipolarisation historique de notre paysage politique a été torpillée et que de nombreux partis sont élus au Parlement : l’Assemblée compte aujourd’hui onze groupes. La diversité semble, ici, assurée non d’ailleurs sans soulever plusieurs problèmes, qu’ils soient politiques (créer et s’assurer une majorité), juridiques (respecter toutes les garanties profitant aux groupes minoritaires et d’opposition) ou pratiques (disposer d’un nombre de salles suffisantes pour permettre toutes les réunions de groupe en même temps).
De surcroît, on ajoutera que le scrutin proportionnel éloigne l’électeur de ses élus, à l’inverse du scrutin majoritaire. Par ce dernier, un électeur peut davantage s’identifier à un élu, celui pour (ou contre) lequel il a voté, dans sa circonscription. Il devient son interlocuteur privilégié. Au contraire, lors d’un scrutin proportionnel, l’électeur d’une circonscription est représenté par une pluralité d’élus : sa représentation est « diluée » et il peut moins s’identifier. Certes, la probabilité que l’un des élus soit proche de ses convictions politiques est alors plus élevée, mais le lien de représentation avec lui est moins fort.
Enfin, une démocratie exige en effet une représentation du peuple et de la Nation dans sa diversité, mais le « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » qu’elle suppose, impose également qu’il y ait un « gouvernement », duquel le peuple est en droit d’attendre une capacité de décision : sinon, il n’est précisément pas en mesure de « gouverner ». Par conséquent, il faut trouver le juste équilibre entre cette double exigence : représenter la diversité et assurer la gouvernabilité. Le scrutin majoritaire le favorise au moins autant, si ce n’est davantage que le scrutin proportionnel, en favorisant l’émergence de majorités.
Au regard de la situation politique actuelle, l’introduction d’un scrutin proportionnel serait-elle de nature à favoriser davantage le compromis politique ?
Bruno Daugeron : C’est le nouvel aspect de la question de la proportionnelle récemment apparu dans le débat sur ce sujet dont il était presque totalement dépourvu jusqu’à présent, tant le motif principal de sa promotion était d’abord la ressemblance entre le corps électoral et l’Assemblée nationale. S’il n’échappe à personne que certains adversaires de la proportionnelle sont devenus ses défenseurs à présent que le scrutin majoritaire leur est défavorable au point de prôner le gouvernement de compromis faute d’être en mesure d’imposer le présidentialisme autoritaire habituel, cet aspect du scrutin proportionnel ne peut être négligé. Car en imposant, généralement par un seul tour, un pluralisme auquel le scrutin majoritaire à deux tours ne parvient que par accident – et encore pas toujours – et qu’une stratégie électorale ne réussit qu’imparfaitement à réduire, la proportionnelle contraint les députés à devoir composer avec les exigences des électeurs. Et donc à délibérer afin de parvenir à un accord par la construction de majorités en sortant du « fait majoritaire » aux effets finalement délétères à long termes : étouffement du débat et image trompeuse d’une majorité parlementaire et électorale homogènes alors qu’il n’en est rien.
Pour autant, cette promotion du compromis n’est peut-être finalement pas le trait marquant du scrutin proportionnel dans le contexte actuel. Paradoxalement, son adoption aurait pour principale vertu de rendre plus visibles le ou les courants dominants dans les urnes qui ne peuvent s’exprimer positivement qu’au premier tour et qui ont du mal à apparaitre en raison des alliances imposées pour le second.
Jean-Philippe Derosier : Les dernières élections législatives ont donné lieu à un éclatement exacerbé du paysage politique, rendant difficile la composition d’une majorité car les différentes forces politiques sont peu enclines au compromis. À l’inverse, il est parfois avancé que le scrutin proportionnel favoriserait un tel compromis car les forces politiques, sachant qu’elles n’obtiendront très vraisemblablement pas la majorité absolue, sont d’emblée placées face à la nécessité de discuter entre elles. C’est ce qu’il se produit dans des pays aguerris à ce mode de scrutin, telle l’Allemagne par exemple.
On peut émettre deux réserves. D’une part, ces compromis émergent toujours au lendemain des élections, donc après que les électeurs se sont exprimés et sans qu’ils aient pu le faire sur l’éventuelle coalition qui est finalement formée. C’est d’autant plus le cas qu’avec un scrutin proportionnel, de nombreuses forces politiques ont leurs chances d’être représentées, donc elles candidatent, donc elles font campagne et doivent alors se distinguer des autres pour capter des voix. En se distinguant, elles forcent les différences et marquent leurs clivages, rendant les rapprochements d’autant plus surprenants au lendemain des résultats. Les coalitions peuvent alors être conclues à rebours de positionnements formulés au cours de la campagne, donc à rebours de ce sur quoi se sont prononcés les électeurs.
C’est une des raisons pour lesquelles le scrutin proportionnel est moins démocratique que le scrutin majoritaire, lequel impose également des coalitions, conclues cependant en amont de l’élection, donc soumises aux électeurs. Qu’aurait dit un socialiste farouchement hostile à La France insoumise si, au lendemain des dernières élections où la campagne se serait vraisemblablement déroulée dans le prolongement des européennes, le PS et LFI s’étaient rapprochés au sein d’un « NFP », alors scellé après l’expression du corps électoral, pour gouverner ensemble ? Sans doute des noms d’oiseau qu’il vaut mieux épargner aux lecteurs…!
D’autre part, l’histoire et la culture politiques et constitutionnelles françaises montrent à quel point nous sommes « césaro-papiste », c’est-à-dire attachés à la figure d’un chef et peu enclins au compromis. Les régimes les plus stables de notre histoire constitutionnelle sont ceux qui ont imaginé un pouvoir exécutif fort, même lorsque le pouvoir législatif pouvait imposer sa diversité (comme sous la IIIe République). Même lorsque Droite et Gauche discutent et construisent ensemble une réforme, lors du vote final, les clivages traditionnels refont surface (telle la « loi Macron », en 2015). Il n’est donc absolument pas certain que le compromis puisse trouver une place pérenne dans notre culture politique et parlementaire, avec ou sans scrutin proportionnel.